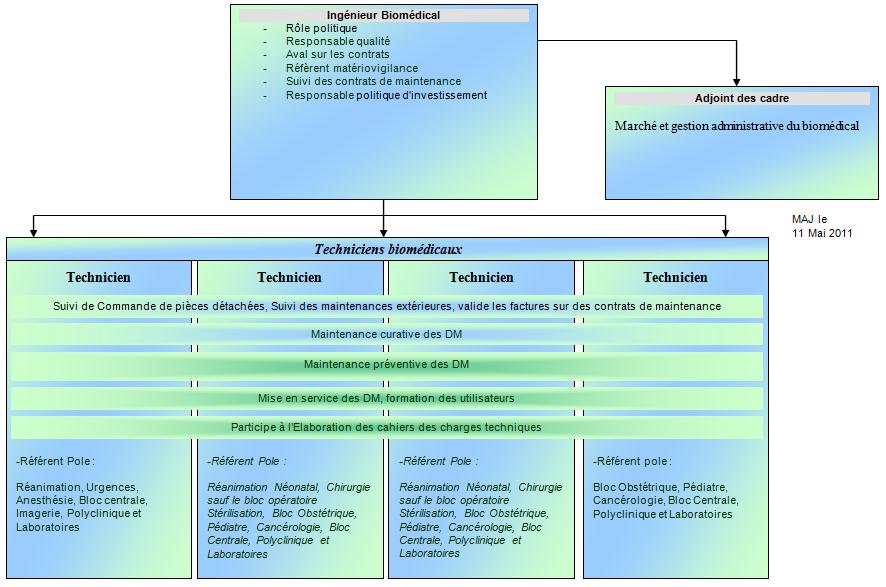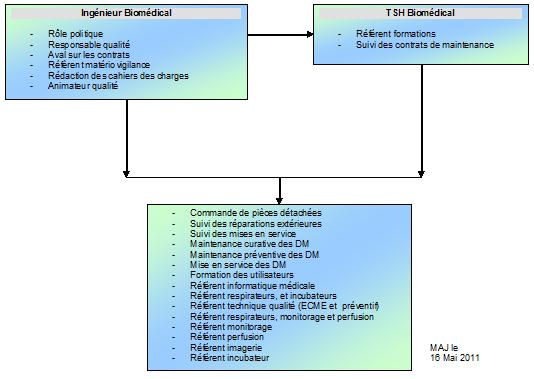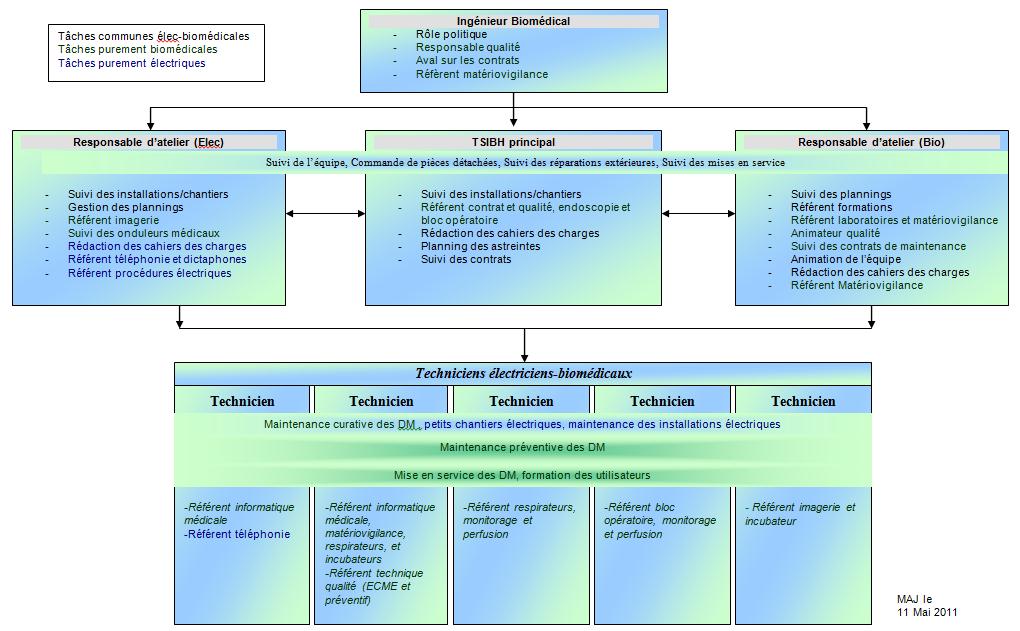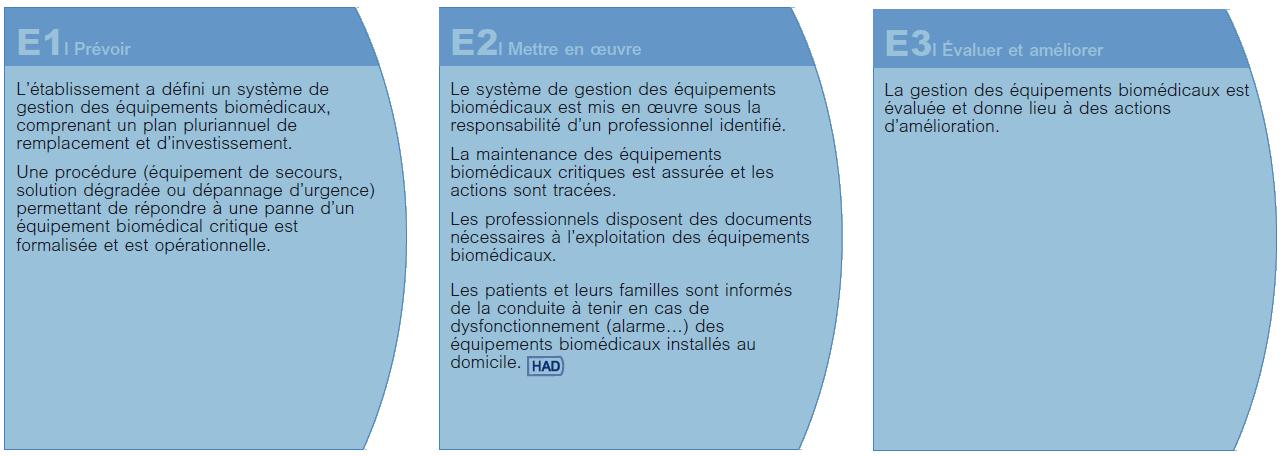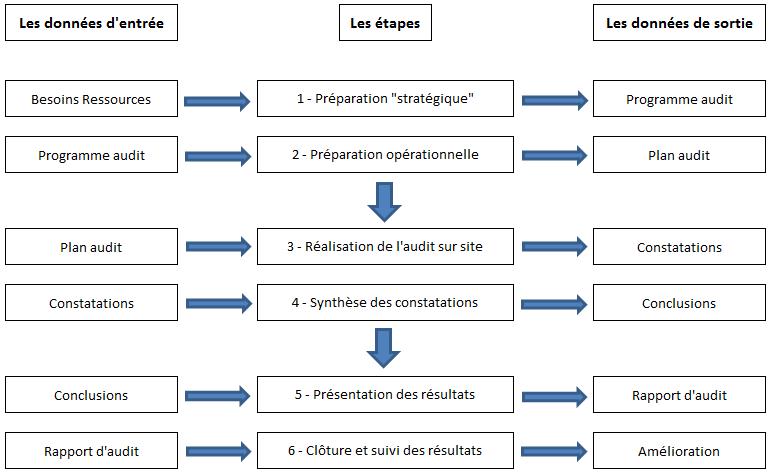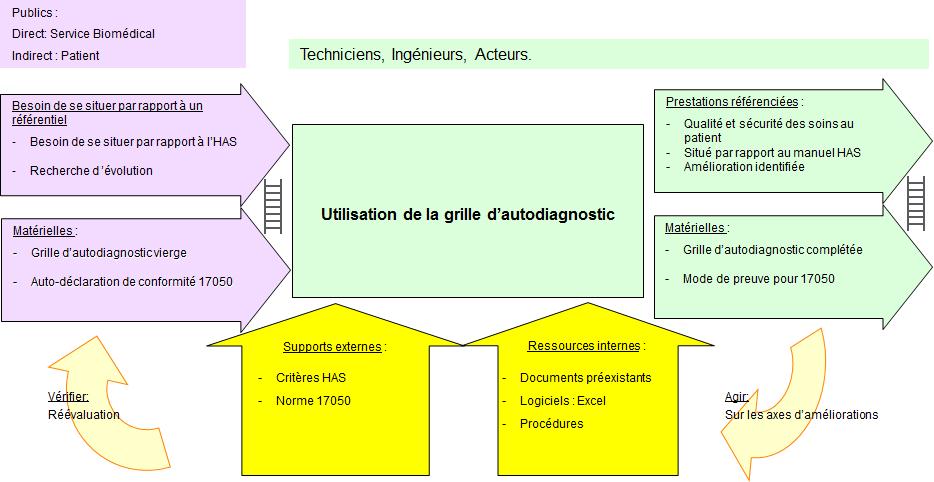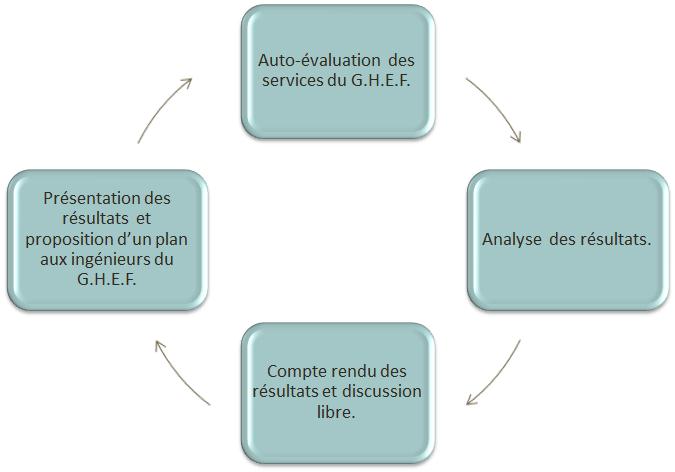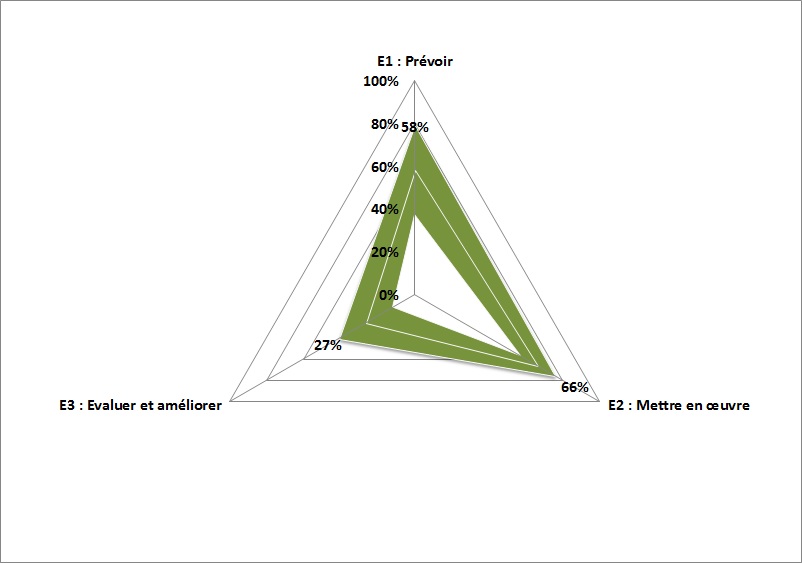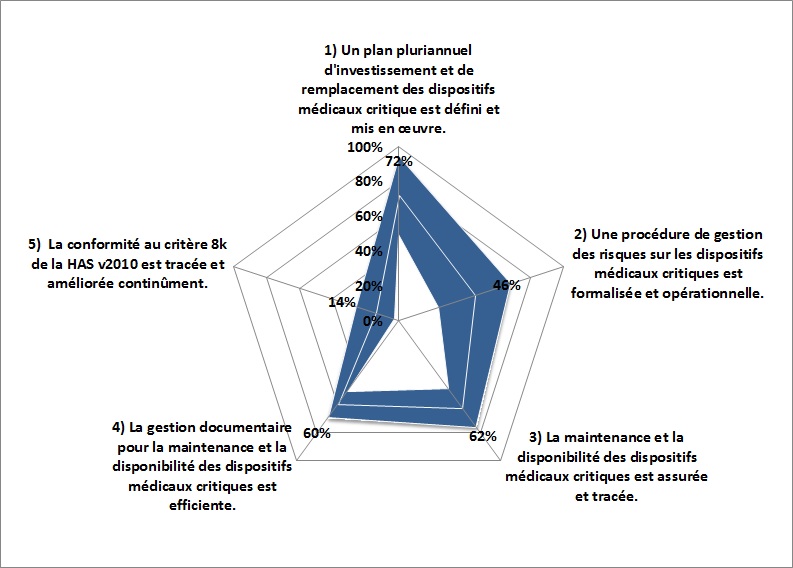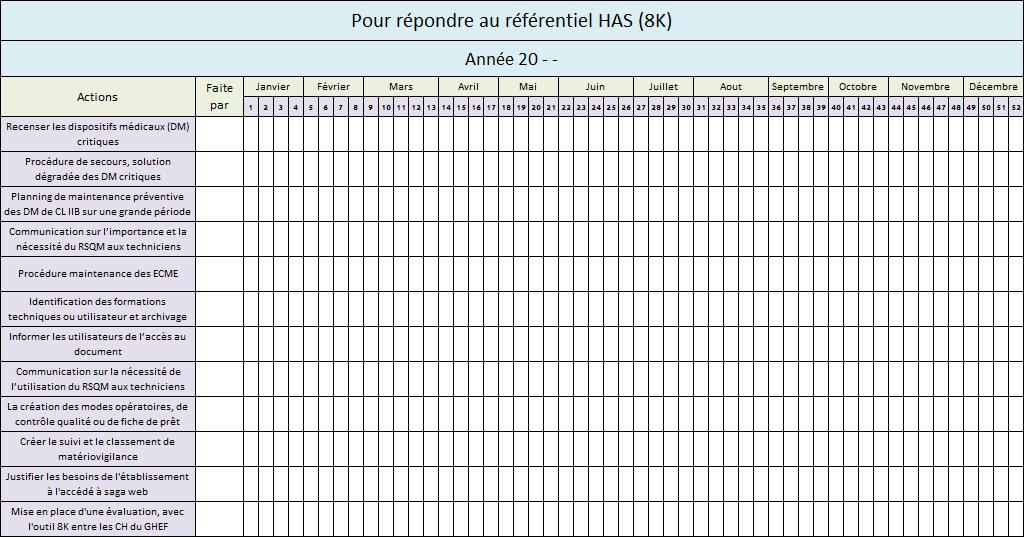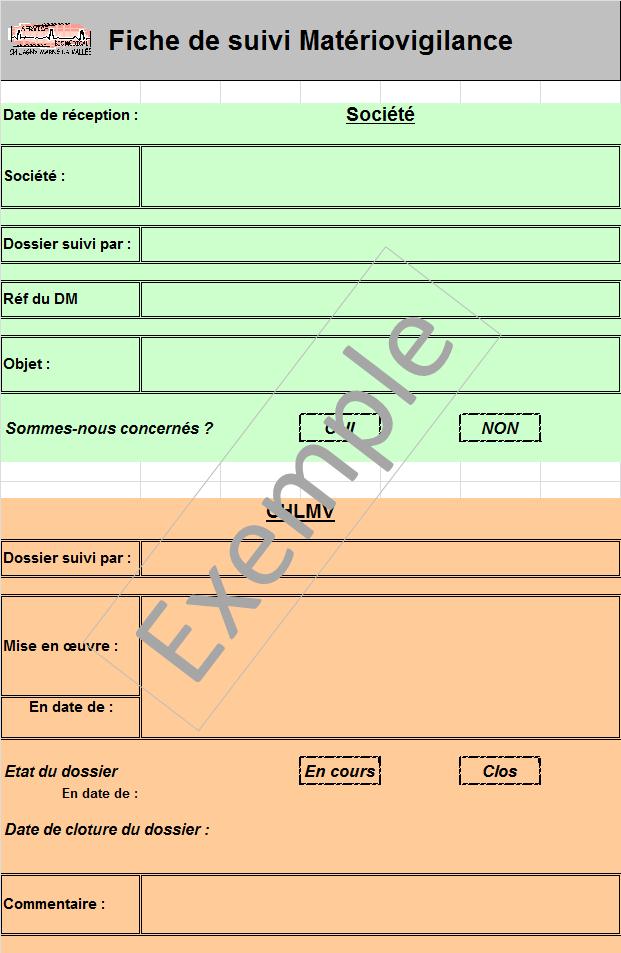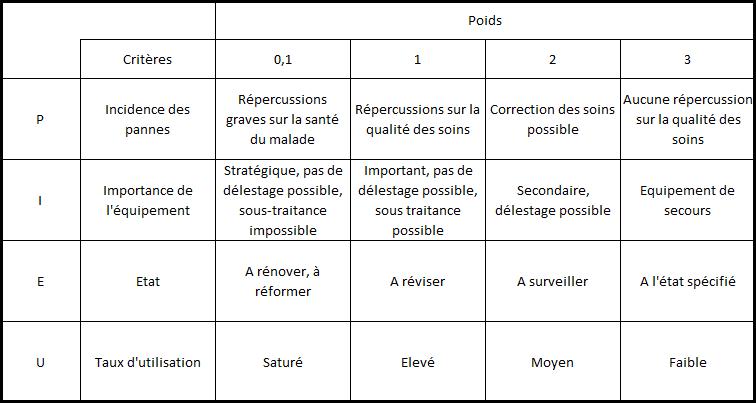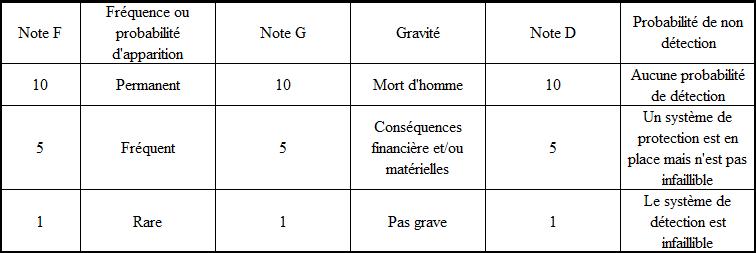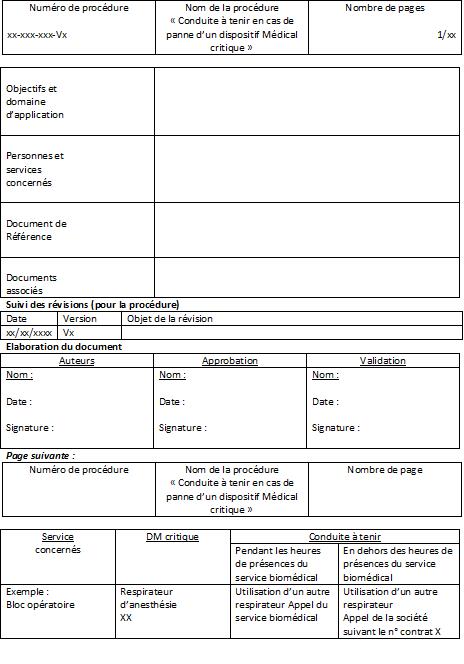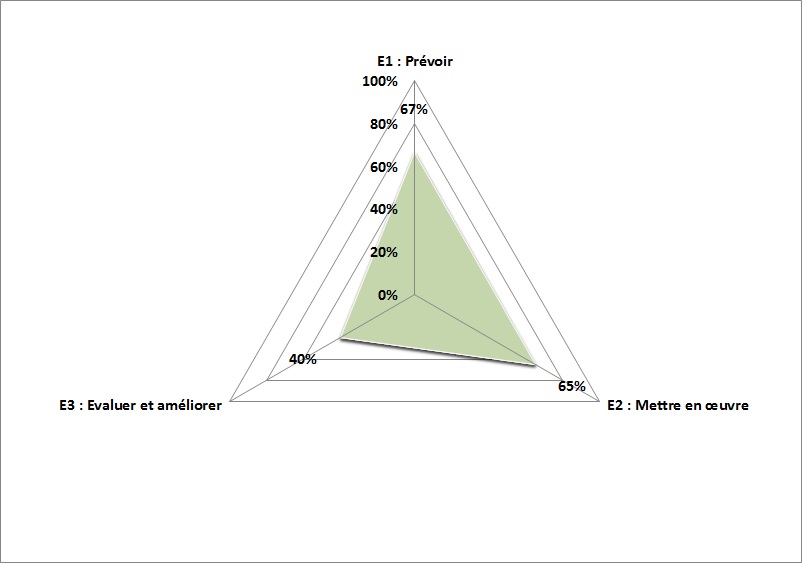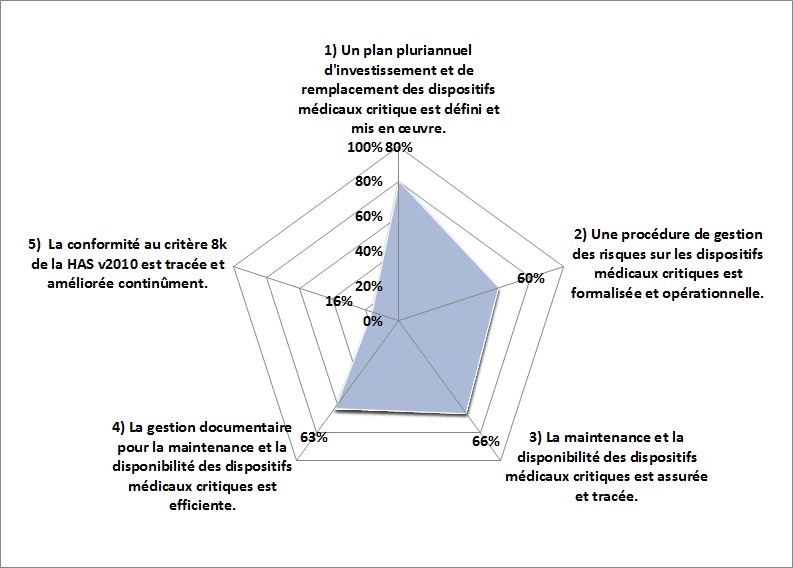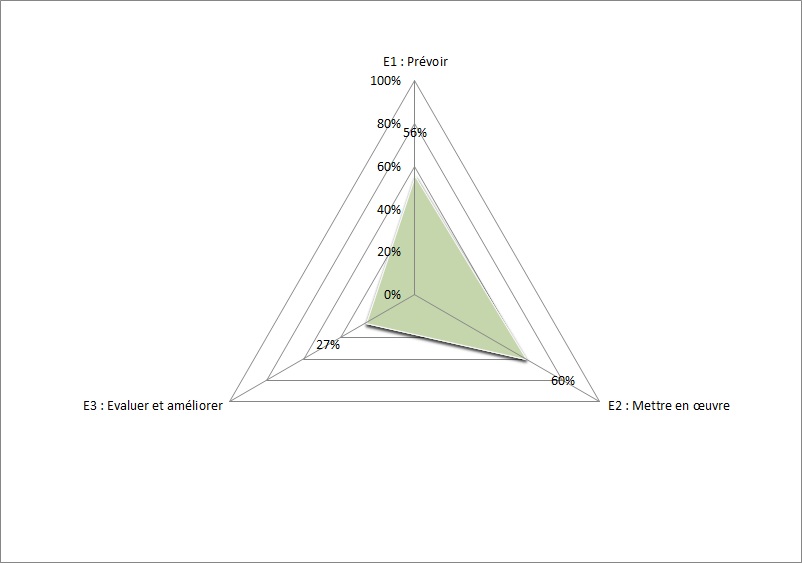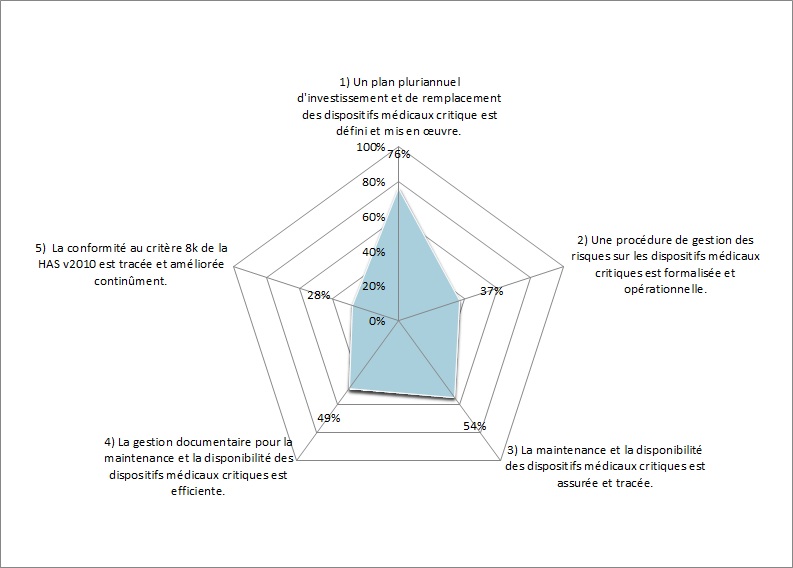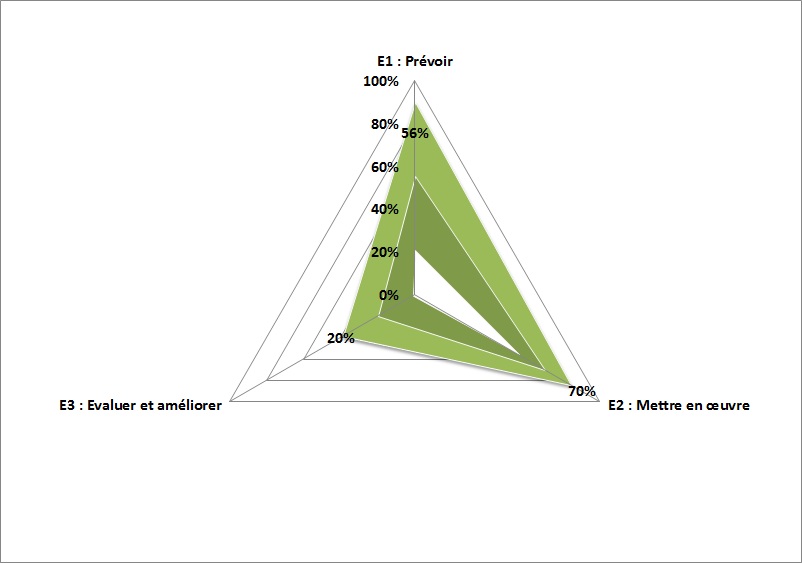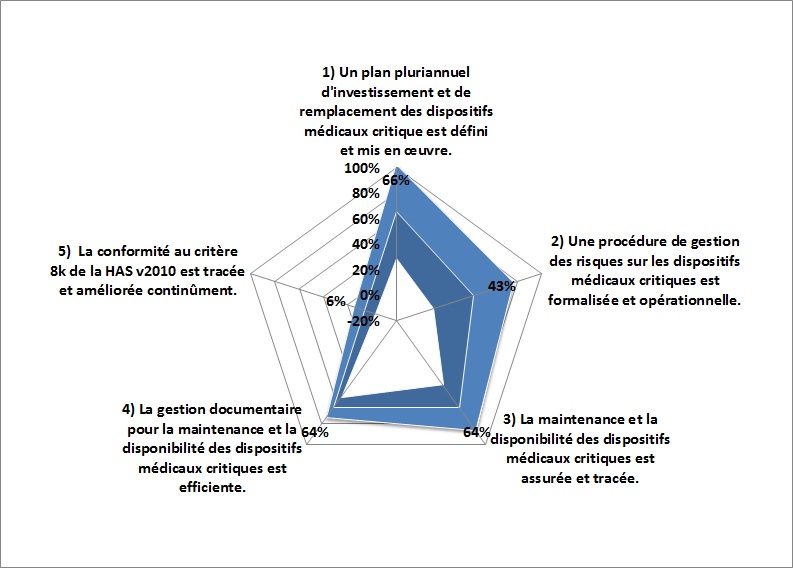|
Avertissement
|
Si vous arrivez
directement sur cette page, sachez que ce travail est un rapport
d'étudiants et doit être pris comme tel. Il peut donc
comporter des imperfections ou des imprécisions que le lecteur
doit admettre et donc supporter. Il a été
réalisé pendant la période de formation et
constitue avant-tout un travail de compilation bibliographique,
d'initiation et d'analyse sur des thématiques associées
aux technologies biomédicales. Nous
ne
faisons
aucun
usage
commercial
et
la
duplication
est
libre.
Si
vous
avez
des
raisons
de
contester
ce
droit
d'usage, merci
de nous en faire part . L'objectif de la
présentation sur le Web est de
permettre l'accès à l'information et d'augmenter ainsi
les échanges professionnels. En cas d'usage du document,
n'oubliez pas de le citer comme source bibliographique. Bonne
lecture...
|
|
Auto-évaluation
sur le critère 8K des services biomédicaux du Groupement
Hospitalier de l’Est Francilien
|
|
|

David DA COSTA |
|
|
|
|
RESUME
La haute autorité de santé(HAS) agit pour
améliorer la qualité dans le domaine de la santé,
elle a défini la ligne à tenir dans un manuel de
certification et a donné ainsi aux établissements de
santé une organisation selon les étapes d’une
démarche d’amélioration.
Le service biomédical étant concerné par les
critères de ce manuel, il se doit de maîtriser ces
pratiques.
Cette étude propose l’utilisation d’un outil
d’auto-évaluation sur le critère 8K de la HAS, qui a
permis aux centre hospitaliers du Groupement de l’Est Francilien de se
situer par rapport au manuel et de s’inscrire dans une démarche
de progrès.
Mots clés : Patient, Haute autorité de
santé, qualité des soins, sécurité des
soins, outil, autoévaluation, 8K HAS, groupement de l'est
francilien.
|
|
ABSTRACT
High health official (HAS) acts
to improve quality in the field of health, it has defines the line to
be held in a handbook of certification and thus gives to the health
care institutions an organization according to the stages of an
approach of improvement.
The biomedical service being concerned with criteria of this handbook,
it must control its practices. This study proposes the use of a tool
for auto-evaluation on the 8K criterion of the HAS, which allowed the
hospital complex Grouping of the East From the Île-de-France to
be located compared to the handbook and to fall under an approach of
progress.
r-evaluation on the 8K criterion of the HAS, which allowed the
hospital complex Grouping of the East Francilien to be located compared
to the handbook and to fall under a step of progress.
Key words : Patient Authority for Health, quality of
care, safe care, tool, self assessment, 8K HAS, the group is francilien.
|
Remerciements
Je tiens tout d’abord à remercier Monsieur Hervé
MIGNARDOT, responsable des services techniques du Centre Hospitalier
Lagny Marne la Vallée, de m’avoir accueilli au sein du service
Electricité/Biomédical pour effectuer mon stage.
Je remercie également Madame Agnès KUZY, ingénieur
biomédical de Meaux ; Monsieur Benoît HERNADEZ
ingénieur biomédical de Coulommiers et Monsieur Patrick
BURAT responsable biomédical de Lagny Marne la Vallée,
pour m’avoir permis de réaliser mon travail dans les meilleures
conditions.
Je remercie vivement Monsieur Pol-Manoël FELAN, Responsable
pédagogique de l’Université Technologique de COMPIEGNE,
pour sa patience, ses encouragements et son encadrement.
J’adresse aussi mes remerciements aux service
électricité/biomédical de Lagny Marne la
Vallée, pour leur patience durant cette période.
Egalement mes plus vifs remerciements à Monsieur FARGES,
Enseignant chercheur à l’Université Technologique de
COMPIEGNE, pour son enseignement, sa patience, sa gentillesse et ses
nombreuses connaissances qu’il a pu me transmettre.
Et enfin je remercie tout spécialement ma compagne et ma fille,
qui m’ont épaulé tout au long de cette formation.
Sommaire
. 31
Projet
de
stage
–
ABIH
2011
Auto-évaluation
des
service
biomédicaux
du
Groupement Hospitalier de l'Est Francilien
Figure
18 : Paysage Lagny
Marne la Vallée

retour
sommaire
La certification [G1] des
établissements de santé est une
démarche ayant pour objectif de concourir à
l’amélioration de la prise en charge des patients dans les
hôpitaux et cliniques sur l’ensemble du territoire
français.
Cette étude a été réalisée dans le
cadre d’un Stage en d’Assistant Biomédical en Ingénierie
Hospitalière et porte sur l'auto-évaluation
sur
le
critère
8K
des
services
biomédicaux
du
Groupement
Hospitalier
de
l’Est
Francilien
(G.H.E.F.).
L’utilisation d’un outil
d’autodiagnostic permettant de se situer sur
le référentiel de l’Haute Autorité de Santé
(HAS) [R1], via le critère
« 8K » dans la «
Gestion des équipements
biomédicaux » en
exploitation dans les établissements de santé, posera un
état des lieux dont l’analyse définira des axes
d’amélioration possible.
Introduction
A.Intérêt
d’une
certification
La certification consiste en une auto-évaluation sur l’ensemble
du fonctionnement de l’établissement suivie d’une visite
réalisée par des professionnels de santé
extérieurs à l’établissement et intègre un
dispositif de suivi qui vise à engager les professionnels de
l’établissement dans une démarche de qualité
durable.
La procédure de certification est naturellement en constante
évolution de façon à s’adapter en permanence aux
exigences des citoyens en matière de qualité et de
sécurité des soins.
"Un travail de fond mobilisant
l’ensemble de ses personnels autour d’un
objectif commun : mieux travailler ensemble pour assurer une prise en
charge de qualité [G2] et
de sécurité des soins
donnés aux patients."
La Haute Autorité de Santé [R2] (1er janvier 2005)
reprend les missions de l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé (ANAES).
Evaluer l’utilité médicale de l’ensemble des actes,
prestations et produits de santé pris en charge par l’Assurance
maladie.
Mettre en œuvre la certification des établissements de
santé.
Promouvoir le bon usage des soins auprès des professionnels de
santé et du grand public.
L’accréditation devient certification.
Les principes et fondements sont :
- Place centrale du patient
- Implication des professionnels
- Amélioration du service médical rendu au patient
- Démarche pérenne et évolutive
La démarche de certification est aujourd’hui installée
dans le paysage sanitaire français :
- La certification a permis d’impulser et de pérenniser la
démarche qualité
- La visite de certification représente un temps fort dans
la vie des établissements de santé
La version 2010 représente une importante évolution du
dispositif de certification.
L’objectif est d’offrir au système de santé un dispositif
qui apporte une réponse pertinente et équilibrée
des attentes des usagers, des professionnels de santé et des
pouvoirs publics :
- La certification doit délivrer une information accessible
et claire à destination des usagers
- Elle doit renforcer sa place en tant qu’outil de management
interne aux établissements
- Elle doit créer les conditions d’un intérêt
à agir des professionnels de santé
- Elle doit enfin assurer son rôle dans la régulation
des établissements de santé par la qualité. Les
résultats de certification doivent devenir
l’élément incontournable pour appréhender la
qualité des établissements.
Si la V1 de la certification avait vocation à initier la
démarche, si la V2 avait privilégié une
médicalisation de la démarche, le nouveau dispositif a
été pensé et développé pour mettre
en œuvre une certification à la fois plus continue et efficiente.
B.La
Haute
Autorité
de
Santé
Institution publique indépendante à caractère
scientifique créée par la loi du 13 août 2004, la
Haute Autorité de santé (HAS) agit pour améliorer
la qualité en santé. Elle accompagne les professionnels
dans l’amélioration de leurs pratiques auprès des
patients et contribue par ses avis à éclairer la
décision publique afin d’optimiser la gestion du panier des
biens et services remboursables.
Depuis sa création en 2005, la Haute Autorité de
Santé s’est attachée à répondre aux
ambitions qui avaient présidé à sa
création. Elle a progressivement trouvé sa place dans le
paysage institutionnel, au service des patients et des usagers, pour un
système de santé solidaire prodiguant des soins de
qualité.
Trois ans après sa mise en place et au terme d’un audit externe
qui a conduit à une nouvelle organisation adaptée
à la conduite de ses missions, la HAS a souhaité se doter
d’un projet stratégique de développement pour les
années 2009-2011. Cette démarche scelle la volonté
de l’institution de mobiliser toutes les marges de progrès
susceptibles d’améliorer sa performance.
LE MANUEL
DE CERTIFICATION V2010
Le document contient les références, les critères
[G3] et les éléments
d’appréciation de la version
2010 de la certification. Ce manuel, établi grâce aux
travaux de groupes thématiques composés de professionnels
de santé, d’experts et de représentants d’usagers, a fait
l’objet d’une relecture par les différentes parties prenantes et
les institutions concernées par la certification des
établissements de santé.
La
structure du manuel
Les choix retenus pour la structure du manuel sont un plan en deux
chapitres :
- chapitre I : Management [G4]
de l’établissement
- chapitre II : Prise en charge du patient.
La HAS a fait le choix d’une meilleure évaluation du
système de management et d’une simplification de la structure du
manuel, en évitant des redondances entre les exigences relatives
à la définition des politiques et celles qui concernent
leur mise en œuvre et leur évaluation. Une organisation des
éléments d’appréciation selon les étapes
d’une démarche d’amélioration.
Pour améliorer la lisibilité du manuel et structurer le
dispositif de cotation, chaque élément
d’appréciation est classé en V2010 dans trois colonnes
E1, E2 et E3.
L’organisation des éléments d’appréciation
facilite la compréhension par les utilisateurs du manuel
(établissements, experts-visiteurs) des exigences relatives au
critère.
Le niveau atteint par l’établissement sur les différents
éléments d’appréciation permet de
déterminer une cotation du critère en 4 classes A, B, C,
D qui correspond à une estimation du niveau de qualité de
l’établissement sur le critère.
I.Groupement de l’Est
Francilien
Le Groupe Hospitalier du Nord Est Francilien réuni les Centres
Hospitaliers de Coulommiers, Lagny Marne la Vallée et Meaux. Ces
trois Centres Hospitaliers ont décidé de constituer en
2005 un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS). Son objectif
est de coordonner les missions de service public de ses membres, de
développer et d’encadrer leurs actions de coopération et
de mettre en place un projet stratégique commun, pour les
activités de court séjour, de psychiatrie, de soins de
suite et réadaptation.
Afin de supporter ces exigences de coordination et de
coopération, et suite au projet national «Hôpital
2012» relatif au système d’information, les trois
établissements ont décidé de mener une
réflexion commune sur les systèmes d’information en
s’appuyant sur le cadre du GCS, dont l’objet a été
étendu à la définition des orientations
stratégiques cohérentes en termes de Système
d’Information.
Par ailleurs, les contraintes multiples et les situations respectives
des systèmes d’information de chacun des établissements
rendaient impérative la mise en œuvre d’un Système
d’Information de Production de Soins au sein de chacun des
établissements.
Les réflexions du GCS ont abouti à la conclusion d’une
nécessaire convergence des systèmes d’information de
production de soins ainsi que des ressources nécessaires
à leur mise en œuvre.
A.Centre Hospitalier
de Meaux d’après [R3]
1.Présentation
L’Hôpital Général de Meaux, lointain
héritier de l’Hôtel Dieu, nous rappelle que la
santé fut de tout temps le souci primordial des hommes.
L’Hôpital de Meaux est l’héritier de plusieurs fondations
ou hospices dont l’activité remonte au Moyen-Age. Il semble que
le premier établissement soit dû à l’initiative de
Jean-Rose, grand bourgeois de Meaux qui s’occupait du commerce du grain
au XIVème siècle.
Son
histoire
Le 29 octobre 1845, un hospice général fut bâti rue
Saint-Faron. Il devait abriter 350 malades.
Il fut modernisé en 1945. De nouveaux bâtiments furent
construits en 1956.
De 1962 à 1969, un deuxième établissement pour
convalescents et personnes âgées fut construit à 3
kilomètres de l’Hôpital, sur le site d’Orgemont. En 1965,
s’ouvrit l’Ecole d’Infirmières.
En 1972, ouverture du Bloc Chirurgical sur le site Saint-Faron
équipé d’un plateau technique (sur 6 étages) et
des services de Psychiatrie qui, en 1977, intégreront les locaux
neufs de la Clinique Psychothérapique.
En 1976, les anciens bâtiments de l’Hôpital Saint-Faron
furent démolis et remplacés en 1978 par le “Bloc
Médical”. Depuis, le plateau technique s’est modernisé.
Meaux et sa région possèdent aujourd’hui un outil de
santé performant d’une capacité d’accueil de plus de 900
lits.
Le CH
Meaux occupe une place importante dans le dispositif sanitaire
public du Nord Seine et Marne.
Capacité de
784 lits installés
86 places (hospitalisation partielle)
14 postes (dialyse)
11 places (HAD)
MCO, SSR, SLD, HAD, psychiatrie intra et extra muros
Chiffres
clés 2009
45 343 Hospitalisations
8 330 Interventions chirurgicales
3 006 Accouchements
65 427 Passages aux urgences
173 782 Consultations externes
2 238 Agents et 345 Médecins
Un
schéma directeur ambitieux
Un pôle femme et enfant ouvert en 2007 avec le passage de la
maternité en niveau 3
Un regroupement des sites d’imagerie en 2009
Une filière gériatrique
Un nouveau plateau médico-technique pour début 2013 :
bloc opératoire, urgences, réanimation, laboratoires,
Des
projets innovants
Numérisation des dossiers patients.
Une maison des internes HQE…
Ouverture IRM Partenariat public – privé.
La
Démarche de Certification
V1 en 2006 : 6 points forts et 7 recommandations.
V2 en avril 2010 : en attente des résultats.
Un
programme coordonné
Une Politique et un Programme global 2007-2010, intégrant la
Qualité, la Gestion des Risques, l’Évaluation et
l’écoute client.
Un programme 2010-2014 en cours de préparation avec des
thématiques communes avec les CH de Lagny et Coulommiers
(identitovigilance, accréditation des laboratoires…).
Un
pilotage de la qualité mature
Pérennisation du comité de pilotage qualité-
gestion des risques – évaluation (créé en 2005)
Un service qualité qui s’est adapté aux évolutions
Élargissement du périmètre d’actions de la
COordination des VIgilances et des Risques (COVIRIM)
créée en 2005, avec création d’un bureau
médical de gestion des risques.
Des sous commissions qualité sécurité disposant de
programmes solides
Création d’une sous-commission EPP qui s’est enrichie au moment
de la conduite de la démarche de certification.
2.Le
service
Biomédical
Le champ
d’application de ce
service au niveau biomédical :
- La réception et la réforme des équipements.
- Le suivi de l’inventaire et des interventions dans la Gestion de
la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO).
- Les maintenances préventives et les contrôles
qualités de certains dispositifs médicaux (Comme les
systèmes de monitorages, les défibrillateurs, les
matériels de perfusion).
- Les maintenances curatives de l'ensemble des équipements
sous inventaire.
- Gestion des contrats de maintenance.
- Le stockage des pièces détachées.
- Le conseil à l’achat des dispositifs médicaux.
- La documentation technique.
Fonctionnement
du
service
Biomédical
:
Le service biomédical dispose d’un ingénieur, d’un
adjoint des cadres, de trois techniciens supérieurs hospitaliers
et d’ouvriers professionnels qualifiés.
Chaque technicien organise la maintenance préventive et curative
des équipements de son périmètre, gère la
mise en service du matériel neuf, ainsi que la maintenance
interne et externe.
Ils ont la charge de valide les factures sur les contrats de
maintenance et participent à l’élaboration des cahiers
des charges techniques.
Le service biomédical a réalisé en 2010 :
- 239 Maintenances préventives
- 1541 Interventions curatives
Le service biomédical aura déclenché et/ou suivi
les maintenances réalisées par les sociétés
extérieures à savoir :
- 304 Maintenances préventives extérieures
- 344 Interventions curatives
- 79 interventions curatives mixtes (interne et externe)
Figure 1:
Organigramme
fonctionnel complet du
service biomédical
B.Centre Hospitalier de
Coulommiers d’après [R5]
1.Présentation
Le Centre hospitalier de Coulommiers est un établissement public
de santé.
Les établissements publics de santé sont des personnes
morales, de droits publics dotés de l'autonomie administrative
et financière.
Ils sont soumis au contrôle de l'Etat et à une
réglementation : le Code de la santé publique.
Le Centre hospitalier de Coulommiers se compose de plusieurs sites.
Les
missions du Centre hospitalier :
Les patients :
- Aux urgences,
- En hospitalisation,
- En ambulatoire,
- En consultation externe, dans les domaines de la médecine,
de la chirurgie, de la gynécologie et de l'obstétrique,
de la psychiatrie, des soins de suite et de réadaptation, de la
douleur et des soins palliatifs, de la gériatrie.
Les personnes ayant perdu leur autonomie de vie et en maison d'accueil
spécialisée.
Le suivi médico-psychologique en psychiatrie adulte et
infanto-juvénile (en extra hospitalier).
Assurer la formation :
- Des internes
- Des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture et
des infirmiers (I.F.S.I.)
- Du personnel hospitalier
Organiser et participer à des actions d’information et de
sensibilisation envers le grand public.
Chiffres
au 31 décembre 2010:
449 lits et places dont :
- 258 lits et places de médecine chirurgie
obstétrique,
- 45 lits de soins de suite et de réadaptation et 6 lits
pour les états végétatifs chroniques,
- 96 lits et places en psychiatrie et 44 en maison d'accueil
spécialisée.
Autorisations d'équipement lourd : scanographe et I. R.M.
Personnel médical :
- 65 praticiens hospitaliers (46 à temps plein et 19
à temps partiel)
- 4 assistants,
- 41 attachés,
- 14 praticiens contractuels,
- 21 internes.
Personnel non médical :
- 680 soignants (70,54%),
- 42 médico-techniques (4,35%),
- 111 techniques et logistiques (11.52%),
- 131 administratifs (13,59%).
Données sociologiques :
- 190 hommes (20%),
- 774 femmes (80%).
Formation professionnelle :
- 629 agents en ont bénéficié, ce qui
représente 1098 journées de formation.
Promotion professionnelle :
- 28 agents ont reçu une formation dans le cadre de la
promotion professionnelle.
ACTIVITÉS
Quelques chiffres caractéristiques du Centre hospitalier :
- 133 876 journées,
- 16 720 entrées directes,
- 94 883 passages en externe,
- 29 414 passages aux urgences,
- 1 143 interventions S.M.U.R.,
- 865 naissances.
DONNÉES FINANCIÈRES
COMPTE DE RÉSULTAT
Total charges tous budgets : 74 468 103 € dont 67 132 835 € pour le
budget H
Total produits tous budgets : 75 458 103 € dont 67 132 835 € pour le
budget H
Bientôt la mise en service d’un I.R.M. (imagerie par
résonance magnétique), au Centre hospitalier de
Coulommiers.
La mise en fonctionnement de ce nouvel équipement est
prévue pour juillet 2011.
L'I.R.M. Magnetom Essenza, d'une intensité de champ de 1,5
tesla, permet d'offrir aux patients un diagnostic complet tout en
disposant d'avancées technologiques, à savoir, un tunnel
(aimant) réduit (145cm), un poids total plus léger (3,5T)
et un circuit de refroidissement à l'hélium
optimisé et moins coûteux en maintenance.
ORGANISATION
Établissement public de santé, c’est une personne morale,
de droits publics, doté de l’autonomie administrative et
financière.
Il est soumis au contrôle de l’État et à une
réglementation : le Code de la santé publique.
LA
GESTION DU CENTRE HOSPITALIER EST ASSURÉE PAR :
LE
CONSEIL DE SURVEILLANCE
Composé de 15 membres délibérants, il
comprend trois collèges où siègent des
représentants des collectivités territoriales, des
représentants des personnels de l’établissement et des
personnalités qualifiées, dont des représentants
des usagers.
Il se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle
permanent de la gestion de l’établissement. Il
délibère sur le projet d’établissement, les
conventions passées avec d’autres établissements, le
compte financier et l’affectation des résultats, la
participation de l’établissement à une communauté
hospitalière de territoire, le rapport annuel de
l’activité.
Il est présidé par le député-maire de la
ville de Coulommiers, Monsieur Franck RIESTER.
LE
DIRECTEUR
Dans le cadre de la direction commune des trois établissements
de Meaux, Lagny Marne-la-Vallée et Coulommiers, placée
sous la responsabilité de Monsieur Thomas LE LUDEC, le Centre
hospitalier de Coulommiers est dirigé par Monsieur Benoît
FRASLIN, directeur délégué, assisté d’une
équipe de direction.
Le directeur, président du Directoire, conduit la politique
générale de l’établissement, en concertation avec
le Directoire. Il représente l’établissement dans tous
les actes de la vie civile et agit en justice au nom de
l’établissement. Il exerce son autorité sur l’ensemble du
personnel. Il est compétent pour régler les affaires de
l’établissement autres que celles qui relèvent de la
compétence du Conseil de surveillance, dont il exécute
les délibérations.
LE
DIRECTOIRE
Il est composé de 7 membres, 3 représentants de la
direction (dont le directeur, président) et 4
représentants du corps médical (dont le président
de la Commission médicale d’établissement).
Le Directoire approuve le projet médical et prépare le
projet d’établissement.
Il conseille le directeur dans la gestion et la conduite de
l’établissement.
D'autres instances, consultatives (organes représentatifs), sont
les conseillers du Conseil de surveillance et du directeur.
- La Commission médicale d’établissement
- Le Comité technique d’établissement
- La Commission des soins infirmiers, de rééducation
et médico-techniques
- Le Comité d’hygiène de sécurité et
des conditions de travail
- Les Commissions administratives paritaires
- Le Comité de lutte contre les infections nosocomiales
(C.L.I.N.)
- Le Comité de lutte contre la douleur (C.L.U.D.)
- La Commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge (C.R.U.Q.P.C.)
Le Centre hospitalier de Coulommiers est doté d'un Comité
de lutte contre les infections nosocomiales (C.L.I.N.) en association
avec une équipe opérationnelle d'hygiène qui se
sont engagés dans la lutte contre les infections nosocomiales.
Ils mènent des actions de prévention définies par
un programme annuel transmis à la D.D.A.S.S., des actions de
surveillance dans le cadre des réseaux régionaux, des
actions de formations internes ou externes, en collaboration avec
l'équipe mobile d'hygiène inter hospitalière
basée à Lagny.
Un représentant des usagers siège au C.L.I.N. lors de
l'élaboration des rapports d'activité et du programme
annuel d'actions.
Le Centre hospitalier de Coulommiers s'engage à prendre en
charge la douleur des patients qu'il accueille. Pour faciliter
l'organisation de cette prise en charge, un Comité de lutte
contre la douleur a été instauré (C.L.U.D.).
LE CENTRE HOSPITALIER DE COULOMMIERS
EST CERTIFIÉ.
Afin de suivre les recommandations de l’H.A.S., le Centre hospitalier
de Coulommiers a organisé des groupes de travail
pluridisciplinaires chargés de mettre en œuvre les mesures
correctives nécessaires.
La dernière procédure de certification a eu lieu du 26 au
30 mars 2007, par l'H.A.S. et la prochaine aura lieu en février
2012.
HISTORIQUE
A l’époque des croisades Monsieur Thibaut, homme charitable, par
donation de huit bouges (petites pièces destinées
à recevoir les pauvres) constitue le premier embryon de
l’Hôtel Dieu.
Le Roy Philippe le Bel et son épouse Jeanne de Navarre dotent
l’institution d’une chapelle, il signe la charte constitution de
l’Hôtel Dieu.
Le patrimoine s’enrichit de dons, legs et achats divers, ce qui permet
de perpétuer l’institution.
En cette époque tourmentée par la guerre de 100 ans, les
domaines de l’Hôtel Dieu sont dévastés. En 1411
Regnault Champion fait don de terres aujourd’hui occupées par
l’hôpital René Arbeltier.
La léproserie, située à proximité de
Chailly en Brie, n’est pas affectée par les malheurs de la
guerre. Elle est rattachée à l ’Hôtel Dieu en 1566.
Achats et échanges se multiplient afin de constituer un ensemble
de 48 hectares sur lequel s’élève un corps d’habitation
et ses dépendances.
Achat de la ferme de Mondollot, constituée de 9 parcelles de
terre à Choisy en Brie et de 16 parcelles à
Saint-Siméon.
La chapelle édifiée en 1541, est détruite et une
nouvelle chapelle, de style néo-gothique, est reconstruite en
1864.
L’hôpital de COULOMMIERS bénéficia encore de
quelques dons, notamment celui d’ Abel Leblanc dont le fruit permis en
1946 d’aménager la fondation, portant son nom, pour les
personnes âgées. Entre 1974 et 1979, tous les services de
médecine, chirurgie, maternité,
spécialités, le plateau technique, les services
administratifs, logistiques et techniques s’installent dans les
nouveaux bâtiments situés sur le « plateau du Theil
». En 1976 est construit et mis en service le bâtiment
d’hospitalisation psychiatrique. Entre 1969 et 1992 les bâtiments
de l’hôpital du centre-ville, baptisé Abel Leblanc, sont
rénovés.
La Maison d’accueil spécialisée "l'Arc-en-ciel" a ouvert
ses portes en 2009. Elle accueille 44 patients polyhandicapés.
2.Le service
Biomédical
Le champ
d’application de ce
service au niveau biomédical :
- La réception et la réforme des équipements.
- Le suivi de l’inventaire et des interventions dans la Gestion de
la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO).
- Les maintenances préventives et les contrôles
qualités de certains dispositifs médicaux.
- Les maintenances curatives de l'ensemble des équipements
sous inventaire.
- Gestion des contrats de maintenance.
Le conseil à l’achat des dispositifs médicaux
Fonctionnement
du
service
Biomédical
:
Le service biomédical dispose d’un ingénieur, d’un
technicien supérieur en ingénierie biomédical
hospitalière.
Le service biomédical a réalisé en 2010 :
- 285 Maintenances préventives
- 632 Interventions curatives
Le service biomédical aura déclenché et/ou suivi
les maintenances réalisées par les sociétés
extérieures à savoir :
- 289 Maintenances préventives extérieures
- 127 Interventions curatives
Figure 2 :
Organigramme
fonctionnel complet du
service biomédical
C.Centre Hospitalier
de Lagny, Marne la Vallée d’après [R7]
1.Présentation
Capacité de
588 lits installés
148 places (hospitalisation partielle)
MCO, SSR, SLD, psychiatrie intra et extra muros
Chiffres
clés 2010:
65 585 Hospitalisations
9753 Interventions chirurgicales
2808 Accouchements
59 516 Passages aux urgences
124 988 Consultations externes
1796 Agents et 322 Médecins
Historique
du
Centre
Hospitalier
de
Lagny
Marne
la
Vallée
C’est sous Louis XIV que furent fondés les hôpitaux, suite
à l’édit concernant les hôpitaux
généraux de 1662. Les lettres patentes signées par
Louis XIV transforment le vieil HÔTEL-DIEU en hôpital
général en 1672. Le Roi en fut le premier membre
bienfaiteur en donnant des terres, des fermes et des prés aux
environs. L’hôpital était administré par un
représentant de l’abbé de Lagny (le Père sous
prieur de l’abbaye), le maire de la ville, ou un échevin (juge
magistrat), ainsi que des notables qui devaient rendre compte de leur
gestion.
A la Révolution, l’établissement a pris le nom d’Hospice
civil. En 1792, l’administration jusqu’alors confiée à
des ecclésiastiques, est assurée par une commission
administrative présidée par le maire de la ville.
L’inauguration de l’hôpital Saint Jean a lieu le 23 juin 1879. La
ville comptait environ 1500 âmes en 1673, 4000 habitants en
1879 et 18000 en 1999.
Les bâtiments construits comportaient outre une chapelle, 4
salles : 2 pour les vieillards et 2 pour la médecine et la
chirurgie (80 à 90 lits).
L’essor
de l’hôpital date de l’après-guerre :
Aménagement d’un service de Pneumologie.
Surélévation des ailes du vieux bâtiment pour
l’agrandissement de la chirurgie, modernisation et agrandissement des
services de radiologie et du laboratoire, construction de la buanderie,
de la lingerie et du pavillon administratif, ouverture du service de
radiothérapie.
Construction de deux bâtiments d’hospice de 200 lits
devenus aujourd’hui le pavillon administratif et le pavillon Maurice
Barthes.
Mise en service de 200 lits dans le bâtiment des malades
chroniques (devenu bâtiment Emile Lannoy dans les années
1986 en souvenir de l’ancien directeur) Aménagement du service
de pédiatrie au rez-de-chaussée (aujourd’hui la
cardiologie). Aménagement de la cuisine.
Ouverture du service de cobaltothérapie.
Construction du bâtiment Maxime Vernois pour la psychiatrie (166
lits).
Construction du bâtiment Denis Fournier qui comporte les
unités d’hospitalisation, de Consultations Externes, de
Gastro-entérologie, de Gynécologie, d’Obstétrique,
de Pédiatrie, de Réanimation, d’Urgences (256 lits), de
plateau technique, de bloc opératoire (8 salles), de Radiologie
(3 salles) et du Laboratoire.
Installation d’un scanographe au sous-sol du bâtiment Denis
Fournier, aménagement des locaux du SMUR et construction du
garage SMUR.
L’hôpital de Lagny change de nom par décision du conseil
d’administration, et pour représenter la ville nouvelle
arrivée aux portes de Lagny, il se dénomme
désormais Centre Hospitalier de Lagny Marne-la-vallée.
Construction de la cogénération, premier secours
électrique de l’hôpital.
Création d'un service de médecine nucléaire.
Installation d’un IRM au CHLMV en groupement d’intérêt
économique.
Agrandissement du service D’accueil des Urgences, de la
réanimation et de la cardiologie. Achat d’un nouveau plateau
technique de cardiologie, Remplacement de l’accélérateur
de particules dans le service de radiothérapie.
Construction d’un nouvel hôpital avec le plan hôpital 2012
Les dates clés pour la
construction d’un nouvel hôpital :
- 19 avril 2005 : lancement des appels à candidatures du
concours d’architecture et d’ingénierie
- 13 janvier 2006 : résultat du jury du concours
- 30 novembre 2006 : dépôt de la demande de permis
de construire et la demande d’autorisation d’exploiter
- 7 aout 2007 : autorisation de permis construire
- Octobre 2007 : signature de l’acte authentique d’acquisition du
terrain
- Novembre 2007 : mise en place de panneaux d’information et de
chantier sur le terrain
- 17 octobre 2008 : pose de la 1er pierre en présence de
Madame Roselyne BACHLOT-NARQUIN, ministre de la santé, de la
jeunesse et des sports
- Novembre 2008 : ouverture du chantier
- Septembre 2010 : fin du gros œuvre
- Décembre 2011 fin des travaux
- Fin du 1er semestre 2012 : accueil des premiers patients.
Lieu : JOSSIGNY (77)
Communauté
d’agglomération de Marne et Gondoire
Programme : MCO de 460 lits et places et 125 lits de psychiatrie, un
logipôle
Maitre d’ouvrage : Centre Hospitalier de Lagny Marne la Valée
Maitre d’œuvre : Brunet-saunier architectes
Surfaces : 70 000 m²
Les
services du centre hospitalier de Lagny
L’hôpital est composé de 59 services médicaux, 30
services administratifs et 16 services médico-techniques qui
travaillent ensemble dans le but de satisfaire les besoins des clients
initiaux de l’établissement et des patients.
Les
disciplines médicales principales sont formées :
Du service d’accueil des urgences :
- un service mobile d’urgence et réanimation (SMUR)
- une unité d’accueil des urgences
- une unité d’hospitalisation de très courte
durée (UHTCD)
- une unité médico-judiciaire (UMJ)
- une unité de réanimation médicale
Du secteur médecine – chirurgie – obstétrique :
- Cardiologie, chirurgie viscérale,
gastro-entérologie, gériatrie,
gynécologie-obstétrique,
médecine interne, oncologie, orthopédie,
pédiatrie/néonatalogie, réanimation et
spécialités d’otorhino – laryngologie, ophtalmologie et
stomatologie
De la gériatrie :
- un court séjour gériatrie
- une unité de soins de suite et réadaptation
- cure médicale
- une unité de conseil gérontologique
L’hôpital possède actuellement 340 lits et places pour la
Médecine – Chirurgie – Obstétrique (MCO), 100 lits de
soins de longue durée (gériatrie, soins de suite et
réadaptation) et 257 lits et places pour la psychiatrie des
adultes, de l’enfance et de l’adolescence.
Les services administratifs ont en gestion les affaires
économiques, financières, médicales,
générales et les ressources humaines.
Les services techniques et logistiques
- atelier biomédical et électricité
- atelier plomberie
- restauration et self
- service de nettoyage
- service transport
- atelier menuiserie, maçonnerie, peinture, serrurerie
- blanchisserie
- sécurité incendie
Plateau
technique du centre hospitalier de Lagny
Les filières de soins bénéficient du support
d’équipements médico-techniques complets comportant
notamment :
- Imagerie médicale : Radiologie conventionnelle, scanner,
échographie couleur, angiographie-rythmologie, coronarographie
numérisée, IRM en groupement inter établissements
- Service d’accueil des urgences (SAU)
- Explorations fonctionnelles et endoscopies
- Laboratoire biochimie, bactériologie, hématologie,
virologie, anatomo-cytopathologie
- Pharmacie
- Radiothérapie, accélérateur de particules
- SMUR transports primaires et secondaires
- Blocs opératoires (8 salles)
- Service de collecte et d’analyse de l’information
médicale
Le budget
du centre hospitalier de Lagny
L’hôpital de Lagny Marne-La-Vallée possède deux
budgets.
Un budget d’exploitation de l’ordre de 140 millions d’euros. Il finance
les dépenses de fonctionnement de l’hôpital.
Un budget d’investissement de l’ordre de 10 millions d’euros. Il
finance les acquisitions immobilières, les équipements
(médicaux et logistiques) et les travaux.
2.Le service
Electricité-Biomédical
Le service biomédical au Centre Hospitalier de Lagny Marne la
Vallée assure la réalisation des travaux et la
maintenance des équipements électriques et
biomédicaux. De plus il est l’interface entre le secteur
administratif, le secteur soignant et le secteur médico-
technique. L’intérêt de ce travail est de fournir d’une
manière indirecte des prestations de sécurité et
de fiabilité pour le patient.
Le champ d’application de ce service au niveau électrique :
L’électricité haute tension (HT), travaux de maintenance
de réseau 20 000 Volts ainsi que les postes de transformation.
- L’électricité basse tension (BT), de Tableau
Général de Basse Tension (TGBT) aux prises d’utilisation
(travaux et maintenance)
- La téléphonie fixe et mobile, de l’autocommutateur
aux prises ainsi que tout l’équipement
- La maintenance de l’ensemble des équipements
électriques du centre hospitalier
- La réception, l’installation et le suivi d’inventaire des
équipements électriques
- La formation des utilisateurs à l’utilisation des
équipements électriques
Le champ
d’application de ce
service au niveau biomédical :
- La réception et la réforme des équipements.
- Le suivi de l’inventaire et des interventions dans la Gestion de
la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO).
- Les maintenances préventives et les contrôles
qualités de certains dispositifs médicaux (Comme les
systèmes de monitorages, les défibrillateurs, les
matériels de perfusion).
- Les maintenances curatives de l'ensemble des équipements
sous inventaire.
- Gestion des contrats de maintenance.
- Le stockage des pièces détachées.
- Le conseil à l’achat des dispositifs médicaux.
- La documentation technique.
Fonctionnement
du
service
Electricité-Biomédical:
Le service biomédical dispose d’un ingénieur, d’un TSIBH
Principal, d’un contremaître responsable d’atelier, d’un maitre
ouvrier également responsables d’atelier, d’un mi-temps
secrétariat, de deux techniciens maître ouvriers
et trois ouvriers professionnels qualifiés chargés
d’exploitation, qui ont également en charge
l’électricité et les courants faibles.
Le service biomédical a réalisé en 2010 :
- 380 Maintenances préventives
- Près de 2000 Interventions curatives
Le service biomédical aura déclenché et/ou suivi
les maintenances réalisées par les sociétés
extérieures à savoir :
- 945 Maintenances préventives extérieures sous
contrat (et 3700 pour les prises et détendeurs de fluide
médicaux)
- 43 Maintenances préventives extérieures hors contrat
- 400 Interventions curatives
Figure 3 :
Organigramme
fonctionnel
complet
du
service
électricité-biomédical [
R8]
II.Auto-évaluation du
« G.H.E.F. »
A.Demande
de
la
HAS
La révision 2011 du manuel V2010 constitue une évolution
qui intègre les apports des développements
réalisés pour répondre aux attentes de
l’environnement et pour tenir compte de l’actualité et du retour
d’expérience mis en œuvre depuis le lancement de la V2010. Cette
révision porte sur un nombre limité de sujets et s’appuie
principalement sur les travaux de trois groupes de travail
réunis entre 2008 et 2010 à l’initiative de la HAS sur
les champs de l’hospitalisation à domicile (HAD), de la
santé mentale et de la biologie.
Chaque élément d’appréciation est classé en
trois colonnes E1, E2 et E3 ce qui correspond aux étapes
classiquement rencontrées dans une démarche
d’amélioration : prévoir, mettre en œuvre,
évaluer, améliorer.
Dans le référentiel de la HAS on y retrouve dans le
chapitre 1 « MANAGEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT », Partie
3 « Management de la qualité et de la
sécurité des soins », Référence
8 « Le programme global et coordonné de management
de la qualité et de la sécurité des soins »,
le critère 8k « Gestion des équipements
biomédicaux ».
Ce critère incombe directement au service biomédical.
Critère
8k
[R9]: Gestion
des équipements
biomédicaux.
Ce critère se situe dans le manuel du référentiel
de certification des établissements de santé
délivré par la Haute Autorité de Santé
(HAS) dans sa version 2010 mis à jour en avril 2011.
Ce manuel, est établi grâce aux travaux de groupes
thématiques composés de professionnels de santé,
d’experts et de représentants d’usagers. Il est structuré
en 2 chapitres :
- Chapitre I : Management de l’établissement
- Chapitre II : Prise en charge du patient
Il vise la certification des établissements de santé et
il porte sur le fonctionnement global de l’établissement.
Il poursuit 2 objectifs :
- La mise en place d’un système de pilotage
- L’atteinte d’un niveau de qualité sur des
critères thématiques jugés essentiels.
Il contribue à la régulation des établissements de
santé par la qualité.
- Situation du critère 8K dans l’organisation du manuel HAS :
Cette activité est définie dans :
- Chapitre I : « Management de l’établissement
»
- Partie 3 : « Management de la qualité et de la
sécurité des soins ».
- Référence 8 : « Le programme global et
coordonné de management de la qualité et des risques
» et à travers le critère 8K « Gestion des
équipements biomédicaux ».
Ce critère décrit les étapes obligatoires pour la
gestion et la maintenance d’un dispositif biomédical [G6] et
défini pour la première fois l’organisation d’un service
biomédical. Cette reconnaissance par les pairs fait suite
à une volonté de la profession de maîtriser et
d’améliorer ses pratiques.
Il organise les éléments d’appréciation selon les
étapes d’une démarche d’amélioration :
prévoir, mettre en œuvre, évaluer et améliorer.
Dans le cadre de la certification par la H.A.S v2010 des
établissements de santé, l’activité
biomédical est reconnue, à travers le critère 8k,
comme contribuant à la qualité des soins et à la
sécurité des patients, ce qui leur donne aussi des
obligations.
Aussi l’évaluation est primordiale parce qu’elle permet de
mesurer les performances (efficacité [G7], efficience [G8])
des
pratiques
demandées.
Elle
est
donc
essentielle
pour
identifier
les
points
forts
et
les
axes
d’améliorations,
et
se
doit,
par
une procédure de
certification obligatoire d’intervenir périodiquement.
B.Formation et choix de
l’outil
L’évaluation consiste à comparer ce qui est
réalisé par rapport à ce qui est attendu par l’HAS.
Il existe différentes modalités d’évaluation.
- L’auto évaluation
est une observation à effectuer
régulièrement par le service biomédical ou une
personne extérieure (Exemple : responsable qualité, un
pair, etc.).
- L’évaluation est
réalisée par un
comité d’audit composé de personnes indépendantes
et extérieures au monde biomédical, afin de
vérifier la conformité du service par rapport au
référentiel.
Si l’on souhaite améliorer nos pratiques avant une
évaluation, une auto-évaluation est
préconisée.
1.Formation à
l’auto-évaluation
« Auditer » vient du latin « auditare » qui
veut dire écouter…
Il m’a fallu tout d’abord me former à la pratique des
audits, afin d’identifier les bonnes pratiques à déployer
dans cette situation. J’ai donc sollicité les conseils de Melle
Hanriot chargée de mission de la qualité et du
développement durable au sein du centre hospitalier de Lagny.
L’audit, quel bel exercice ! Et pourtant cet exercice est des plus
difficiles car il demande de la préparation, de la
concentration, de l’exactitude, de la synthèse, de la
clarté, de la communication, de la syntaxe, de la conviction, …
et le tout en un minimum de temps.
D'après l'ISO 9000 [N6]
l'audit est un :
« Processus méthodique [G9],
indépendant
et
documenté
en
vue
d’obtenir
des
preuves
et
de
les
évaluer
de
manière
objective
pour
déterminer
dans
quelle
mesure
les
critères
sont
satisfaits
».
L’audit est un travail qui demande une longue préparation, ou il
est nécessaire de transmettre aux personnes auditées les
critères de réalisation en leur laissant le temps d’en
prendre connaissance.
Il faudra ensuite identifier les modes de preuve qui vont être
fournis.
Le bilan de l’audit sera évaluer sur trois niveaux (observation,
remarque, non-satisfait) appelé échelle de risque par les
auditeurs.
Le diagramme qui suit regroupe les trois grandes étapes à
faire pour un audit :
Après avoir capitalisé les informations sur l’audit, je
me suis inspiré de ces trois étapes que sont la
préparation, la réalisation, l’amélioration. Il
m’est apparu évident que l’identification des axes
d’amélioration nécessite l’évaluation sur le
critère 8K de l’HAS.
Il faudra tout de même retenir que l’évaluation est un
travail préparatoire, alors que l'audit permet de conclure sur
la satisfaction à des critères. Mais aussi que
l’évaluation comme l'audit ont vocation à être
suivis d'une phase d'amélioration.
2.Choix
de
l’outil
Force de constater que l’audit n’est pas l’approche attendue par le
GHEF, mon choix c’est tout naturellement porté sur un outil
élaboré à partir de chaque processus E1, E2, E3,
créés par des élèves de la formation ABIH
2009, sur l’élaboration d’une « Grille d'autodiagnostic
sur le Critère 8k v2010 de l'H.A.S » [R10], Ceci dans le but de permettre à la
communauté de faire un diagnostic [G11],
afin de s’évaluer sur les exigences du référentiel
de certification H.A.S v2010
Il m’a fallu apporter des modifications à l’outil, suite
à la mise à jour faite par la HAS avec la révision
d’avril 2011. Ainsi la donnée « Les patients et leurs
familles sont informés de la conduite à tenir en cas de
dysfonctionnement (alarme…) des équipements biomédicaux
installés au domicile. », qui ne concerne que les
établissements de santé qui gèrent les
hospitalisations à domicile a fait son apparition dans l’outil.
Pour cela, il m’a fallu doter l’outil de la valeur « non
applicable » sur l’échelle de véracité, avec
la précision que cette valeur n’est utilisable que sur le
critère 4.6 (HAD) et sans pénaliser les
établissements qui ne pratiquent pas la HAD.
Après modification, l’outil a été soumis à
validation à Monsieur FARGES, enseignant chercheur à
l’Université Technologique de COMPIEGNE, ce qui a eu pour effet
de maintenir la validité de l'outil vis-à-vis des
évolutions du Manuel de Certification et permis la mise à
disposition de cet outil à la communauté
biomédicale.
Structure
de la grille avec échelle de véracité
L'ensemble est décliné selon 5 processus associés
chacun à des critères de réalisation (30 au total).
L’évaluation de ces critères se fait suivant 6 niveaux de
véracité plus un niveau HAD:
- Faux unanime : A
l'unanimité, on peut dire que l'action
n'est pas réalisée
- Faux : Une personne au
moins considère que l'action est en
partie réalisée
- Plutôt faux : Rien
ne permet d'identifier la
réalisation de l'action
- Plutôt vrai :
L'action est réalisée de
manière aléatoire
- Vrai : L'action est
systématiquement réalisée
- Vrai prouvé : La
réalisation de l'action est
systématique et peut être prouvée
- Non applicable : la
valeur non applicable peut être
utilisée sur le point 4.6 pour la HAD
Cette échelle est volontairement asymétrique ; ainsi sans
point milieu, les indécis s’impliqueront d’avantage dans la
réponse.
Pour garantir d’éventuelles comparaisons concluantes entre
services, il ne faut pas moins de 6 niveaux. Par contre, trop de
niveaux nuiraient à la fluidité de
l’autoévaluation.
Les 5
processus de l’outil
L’outil est composé de 5 processus avec un total de 30
critères ; voici les processus :
- Un plan pluriannuel
d'investissement et de remplacement des
dispositifs médicaux critiques [G10] est
défini et mis en
œuvre.
- Une procédure de gestion des
risques sur les dispositifs
médicaux critiques est formalisée et
opérationnelle.
- La maintenance et la
disponibilité des dispositifs
médicaux critiques est assurée et tracée.
- La gestion documentaire pour la
maintenance et la
disponibilité des dispositifs médicaux critiques est
efficiente.
- La conformité au
critère 8k de la HAS v2010 est
tracée et améliorée continûment.
Utilisation
de
la
grille
Figure 6 :
Cartographie
du
processus
"Utilisation
de la grille autodiagnostic"
Comme l’explicite la cartographie ci-dessus, la grille permet à
un service biomédical de se situer par rapport au critère
8K de l’HAS et d’identifier des axes d’amélioration. Elle va
donc, indirectement, permettre au service de garantir la qualité
et la sécurité des soins au patient.
Etant conçu pour être compatible ISO 17050 [N4] cet outil
peut servir comme mode de preuve de conformité.
Les données issues de l’utilisation de la Grille
d'autodiagnostic sur le Critère 8k v2010 de l'H.A.S
peuvent entrer dans un processus d’amélioration continu qui
permet d’agir sur les axes d’améliorations à entreprendre
et de les réévaluer par le même processus. Cette
méthode s’inscrit dans une démarche de progrès.
C.L’auto-évaluation
L’auto-évaluation est le meilleur outil d'amélioration
continue promu par tous les référentiels internationaux
relatifs à la qualité.
Définition de l’auto-évaluation par l’ISO 9000:2005 [N5]
: revue complète et méthodique des activités et
des résultats de l’organisme. Elle peut fournir une vision
globale des performances, du niveau de maturité des processus et
contribuer à identifier les domaines nécessitant des
améliorations et leurs priorités.
Comme l’indique le déroulement ci-dessous, j’ai
accompagné les services biomédicaux dans leurs
premières auto-évaluations. L’analyse des
résultats obtenus les a situés par rapport au
critère 8K de l’HAS et a permis l’identification des axes
éventuels d’amélioration. Tout ceci toujours dans le but
ultime de garantir la qualité et la sécurité des
soins au patient.
Figure 7 :
Déroulement
de
l’auto-évaluation
D.Résultats
Meaux
L’auto-évaluation du service biomédical de Meaux a
été faite par Madame KUSY ingénieur et
moi-même.
Les résultats sur les demandes de l’HAS [A5] :
- E1 prévoir 67%
- E2 mettre en œuvre 65%
- E3 évaluer et
améliorer 40%
Ces résultats peuvent laisser supposer que la note de ce
critère par un groupe d’audit, serait d’au moins « B
» en rapport avec le système de notation de L’HAS [R9].
Ce qui donne :
« B = le critère (8K) est souvent ou partiellement
satisfait. Le centre répond souvent ou partiellement aux
éléments d’appréciation proposés ou apporte
d’autres éléments lui permettant de satisfaire, en partie
au critère. »
Les résultats sur les processus de l’outil 8K [A6] :
- Un plan pluriannuel d'investissement et de remplacement des
dispositifs médicaux critiques est défini et mis en œuvre
: 80%
- Une procédure de gestion des risques sur les dispositifs
médicaux critiques est formalisée et
opérationnelle : 60%
- La maintenance et la disponibilité des dispositifs
médicaux critiques est assurée et tracée : 66%
- La gestion documentaire pour la maintenance et la
disponibilité des dispositifs médicaux critiques est
efficiente : 63%
- La conformité au critère 8k de la HAS v2010 est
tracée et améliorée continûment : 16%
Coulommiers
L’auto-évaluation du service biomédical de
Coulommiers a été faite par Monsieur
Hernandez ingénieur et moi-même.
Les résultats sur les demandes de l’HAS [A7] :
- E1 prévoir 56%
- E2 mettre en œuvre 60%
- E3 évaluer et
améliorer 27%
Ces résultats peuvent laisser supposer que la note de ce
critère par un groupe d’audit, serait d’au moins « B
» en rapport avec le système de notation de L’HAS.
Ce qui donne :
« B = le critère (8K) est souvent ou partiellement
satisfait. Le centre répond souvent ou partiellement aux
éléments d’appréciation proposés ou apporte
d’autres éléments lui permettant de satisfaire, en
parties au critère. »
Les résultats sur les processus d l’outil 8K [A8] :
- Un plan pluriannuel d'investissement et de remplacement des
dispositifs médicaux critiques est défini et mis en œuvre
: 76%
- Une procédure de gestion des risques sur les dispositifs
médicaux critiques est formalisée et
opérationnelle : 37%
- La maintenance et la disponibilité des dispositifs
médicaux critiques est assurée et tracée : 54%
- La gestion documentaire pour la maintenance et la
disponibilité des dispositifs médicaux critiques est
efficiente : 49%
- La conformité au critère 8k de la HAS v2010 est
tracée et améliorée continûment : 28%
Lagny
Marne
la
Vallée
L’auto-évaluation du service biomédical de Lagny Marne la
Vallée a été faite par Monsieur MIGNARDOT
ingénieur, Monsieur BURAT responsable biomédical et
moi-même. Le choix d’auto-évaluer le service avec une
personne supplémentaire résulte tout simplement du fait
que Monsieur MIGNARDOT est mon tuteur de stage et pour garder une
impartialité le choix a été de faire une moyenne
des résultats, que voici.
Les résultats sur les demandes de l’HAS [A9] :
- E1 prévoir 56%
- E2 mettre en œuvre 70%
- E3 évaluer et
améliorer 20%
Ces résultats peuvent laisser supposer que la note de ce
critère par un groupe d’audit, serait d’au moins « B
» en rapport avec le système de notation de L’HAS.
Ce qui donne :
« B = le critère (8K) est souvent ou partiellement
satisfait. Le centre répond souvent ou partiellement aux
éléments d’appréciation proposés ou apporte
d’autres éléments lui permettant de satisfaire, en
parties au critère. »
Les résultats sur les processus d l’outil 8K [A10] :
- Un plan pluriannuel d'investissement et de remplacement des
dispositifs médicaux critiques est défini et mis en œuvre
: 66%
- Une procédure de gestion des risques sur les dispositifs
médicaux critiques est formalisée et
opérationnelle : 43%
- La maintenance et la disponibilité des dispositifs
médicaux critiques est assurée et tracée : 64%
- La gestion documentaire pour la maintenance et la
disponibilité des dispositifs médicaux critiques est
efficiente : 64%
- La conformité au critère 8k de la HAS v2010 est
tracée et améliorée continûment : 6%
Moyenne
des
trois
établissements
de
santé
Avec l’utilisation des résultats des trois centres hospitaliers,
une lecture claire et synthétique des moyennes obtenues, nous
donne les axes d’améliorations appropriés à la
situation.
Les résultats sur les demandes de l’HAS :
- E1 prévoir 58%
- E2 mettre en œuvre 66%
- E3 évaluer et
améliorer 27%
Résultat
HAS
du
GHEF
Ces résultats peuvent laisser supposer que la note de ce
critère par un groupe d’audit, serait d’au moins « B
» en rapport avec le système de notation de L’HAS.
Ce qui donne :
« B = le critère (8K) est souvent ou partiellement
satisfait. Le centre répond souvent ou partiellement aux
éléments d’appréciation proposés ou apporte
d’autres éléments lui permettant de satisfaire, en
parties au critère. »
Les résultats sur les processus d l’outil 8K :
- Un plan pluriannuel d'investissement et de remplacement des
dispositifs médicaux critiques est défini et mis en œuvre
: 72%
- Une procédure de gestion des risques sur les dispositifs
médicaux critiques est formalisée et
opérationnelle : 46%
- La maintenance et la disponibilité des dispositifs
médicaux critiques est assurée et tracée : 62%
- La gestion documentaire pour la maintenance et la
disponibilité des dispositifs médicaux critiques est
efficiente : 60%
- La conformité au critère 8k de la HAS v2010 est
tracée et améliorée continûment : 14%, ce
résultat s’explique par le faite que c’est la première
année d’utilisation de l’outil.
Résultat des processus du GHEF
Figure 17:
Cartographie
processus
métier
du
GHEF
III.Améliorations
identifiées
et
bilan
A.Les
améliorations identifiées pour le groupement
Présentation
suite
à
l’utilisation
de
l’outil
8K
Après l’auto-évaluation, et à partir du
diagnostic, le groupe a défini des axes d’amélioration.
Les axes sont issus de l’analyse des réponses aux
critères qui nécessitent une attention
particulière. Ils regroupent les besoins de façon plus
générale, et ainsi identifient l’action à mettre
en place le plus rapidement possible entre les établissements
(réflexion en cours).
La présentation des résultats se fait lors d’une
réunion plénière ; l’exposé de mon travail
donne la possibilité à la communauté des services
biomédicaux du GHEF d’une complémentarité des
actions à réaliser.
J’apporte pendant cette réunion un plan d’amélioration,
avec l’acceptation de l’étude proposée aux trois
ingénieurs ; elle devient «
Le
plan
d’action
du
Groupement
Hospitalier
de
l’Est
Francilien
».
En s’appuyant sur les « cartographies » de
résultats, ainsi que sur les nombreux échanges ayant eu
lieu lors de ces rencontres, des axes d’amélioration possibles
sont définis pour les processus suivant :
- Un plan pluriannuel d'investissement et de remplacement des
dispositifs médicaux critiques est défini et mis en
œuvre.
Le plan est défini pour la
totalité des dispositifs médicaux et regroupe bien les
informations nécessaires telles que la procédure d’achat,
les dates d’échéances, les personnes qui gèrent
les dossiers, un planning qui regroupe l’ensemble des interlocuteurs,
les objectifs, etc. Le plan est revu au moins une fois par an.
Cependant les dispositifs
médicaux critiques sont noyés dans la liste qui regroupe
l’ensemble des DM, les processus des actions sont connus par les
ingénieurs mais ne sont pas écrits et non
communiqués.
La réponse des établissements est en concordance avec la
demande de la HAS, qui demande un plan pour la gestion des
équipements médicaux.
- Une procédure de gestion des risques sur les dispositifs
médicaux critiques est formalisée et
opérationnelle.
- Recenser les dispositifs
médicaux critiques dans un tableau avec une méthode
appropriée exemple avec la méthode PIEU ou AMDEC. Je
pense que la classe des DM ne doit pas rentrer en compte dans ce
classement et doit rester propre à chaque établissement.
- Répondre à la gestion des risques avec la
création des procédures de secours, d’urgence, de
solutions dégradées pour les dispositifs médicaux
critiques, cela contribue également au besoin des soignants.
- La maintenance et la disponibilité des dispositifs
médicaux critiques est assurée et tracée.
- Un planning de maintenance
préventive, en tenant compte des dates de contrôles les
plus éloignées (DM de CL II B) exemple : un DM avec un
contrôle préventif tous les trois ans, donne lieu à
un planning de maintenance tous les trois ans.
- Communiquer sur l’importance et la nécessité du RSQM
à toute personne susceptible de le remplir, pour ainsi favoriser
leur l’implication.
- Une procédure de contrôle des ECME définissant
les appareils à contrôler, les actions à
réaliser, l’archivage et les indicateurs pour les appareils ok
ou ayant nécessité une action de calibration et/ou de
réparation.
- L’identification des formations techniques ou utilisateurs sont
à identifier et à archiver ; l’identification doit
être prévue dès l’achat.
- Réaliser un tableau de bord sur la maintenance et la
disponibilité des DM, à la suite du recensement des DM
critiques.
- La gestion documentaire pour la maintenance et la
disponibilité des dispositifs médicaux critiques est
efficiente.
- Informer les utilisateurs sur la
marche à suivre pour l’accès au document d’utilisation.
Exemple : l’accès informatique (intranet), le lieu et la
disponibilité des documents papier (externe au service) ou la
démarche pour toute demande.
- Informer les techniciens sur la consultation du RSQM avant une action
corrective peut déterminer si les DM ont des pannes à
répétitions.
- La création des modes opératoires, de contrôles
qualité, de fiches de prêt sont à mettre à
disposition et à valider avec les techniciens.
- Suivi de la matériovigilance et du classement des documents,
mise à disposition des techniciens pour toute demande des
utilisateurs des DM.
- L’accès aux normes suivant les besoins est à envisager,
l’utilisation d’un accès peut être permise par tous les
corps d’état (technique, informatique, biomédical,
etc.) ; la demande est à faire par le service qualité
après l’identification des domaines de thématiques.
- Identifier les services soignants qui pratiquent de l'Hospitalisation
A Domicile (HAD) et si les prêts de DM sont fais par les services
soignants ou des prestataires, pour les informer sur la conduite
à tenir en cas de dysfonctionnement.
- La conformité au critère 8k de la HAS v2010 est
tracée et améliorée continûment.
Tous les acteurs préconisent une
auto-évaluation au moins une fois par an et faite par des pairs.
Cela donne lieu à un échange (discussion) sur les
méthodes mises en place et un regard extérieur.
- Un planning pour l’année à venir, pour fixer une
auto-évaluation entre pairs.
- Une veille du « manuel de certification des
établissements de santé » est recommandée
avant l’utilisation de l’outil, pour une mise à jour de la
grille 8K et vérifier si d’autres critères incombe au
service biomédical
- Communiquer auprès de la direction, avec l’impression des
résultats et les cartographies radars de
l’auto-évaluation.
B.Bilan
La mise en commun des résultats donne un aperçu assez
complet des actions et interactions entre les différents
établissements, et ce à chaque étape du parcours.
Une réflexion a été engagée dans le
groupement ; la difficulté consiste à pouvoir
élaborer des axes pour un établissement avec l’aide des
autres.
Plusieurs idées sont proposées et les prioritaires
citées ci-dessous :
- Réaliser un tableau qui récence les DM critiques.
C’est une étape primordiale pour répondre au
référentiel.
- Création des différentes procédures en
identifiant les personnes qui vont les réaliser et ceux
qui vont les valider.
- Mise en place d’une auto-évaluation annuelle entre les
services biomédicaux du GHEF, de par la richesse des
échanges et pourquoi pas solliciter d’autres
établissements pour un benchmarking [G12].
- La présentation aux techniciens de
l’auto-évaluation avec les résultats, les axes
d’amélioration et l’information sur les points ou ils sont
acteurs.
Conscient de la charge de travail de chaque service biomédical,
je mets à disposition :
- Un tableau qui regroupe les axes d’améliorations [A1]
(suite à la moyenne du GHEF).
Ce tableau recense les données de début, de fin et de qui
fait l’action.
- Un exemple de « fiche de suivi matériovigilance
» [A2].
Cette fiche recense les données de réception de la
note, qui gère le dossier, les DM en cause, la mise en
œuvre à réaliser, l’état d’avancement,
commentaires, etc.
- Des méthodes pour le recensement des DM critiques [A3].
- Un exemple de procédure sur la « conduite à
tenir en cas de panne d’un DM critique » [A4].
La création d’un groupe de travail qui pourrait discuter sur les
réponses que chaque établissement donne à la
situation « 8K ». Serait une solution pour
développer une nouvelle fois un échange des bonnes
pratiques entre les établissements.
La déclinaison des axes prioritaires sera faite par les
ingénieurs ou les responsables de chaque service
biomédical, suivant l’évaluation de leur propre
situation. Ainsi l’ingénieur prendra le choix ou pas de
créer un groupe sur le pilotage de la démarche dans son
service biomédical.
La démarche dépend des types d’améliorations
nécessaires, des orientations stratégiques du centre
hospitalier et des possibilités d’action. Cette
définition des priorités permettra ensuite de
déterminer le plan d’actions.
Avant la mise en œuvre de toute action, un responsable pour la
démarche est nommé. Il s’assure de son
acceptabilité par l’ensemble des personnes touchées dans
sa mise en œuvre, présente les actions et détermine leur
calendrier. Il est également chargé de
l’évaluation de l’action (mise en place, résultats).
Aussi, l’exploitation des données collectées
répondra aux objectifs :
- Identifier les « bonnes pratiques »
- Identifier les manques et les points de vigilance
- Faire du technicien un acteur dans cette démarche
- Favoriser les échanges sur les points forts de chaque
établissement
- Maintenir une excellente qualité et sécurité
des soins donnés aux patients
IV.Conclusion et perspectives
La « Grille d'autodiagnostic sur le Critère 8k v2010 de
l'H.A.S » est une solution mise à disposition de la
communauté biomédicale. L’outil
s’avère
idéal
pour
démontrer
sa
situation
en
rapport
au
référentiel
de
l’HAS
et
reste
une
approche
d’amélioration
continue.
Imprimable, elle facilite la déclaration de conformité
auprès d’un groupe d’audit et est aisément
présentable à la direction de l’établissement.
L’outil automatisé sous format Excel, a nécessité
des modifications suite à l’évolution du manuel de
certification de l’HAS. Cette modification a été
validée par Monsieur FARGES, enseignant chercheur à
l’Université Technologique de COMPIEGNE, ce qui a eu pour
conséquence le maintien de
validité de l'outil vis à vis des évolutions du
Manuel de Certification et permet la mise à disposition
de l’outil à la communauté biomédicale.
Les résultats graphiques montrent les forces et faiblesses et
permettent la mise en application d’un plan d’action en vue
d’améliorer la situation. Aujourd’hui suite à la demande
des ingénieurs, l’analyse des besoins a finalement mené
à la réflexion suivante :
- Chaque auto-évaluation devrait être faite par des
pairs et donner lieu à une discussion commune sur les axes
d’amélioration.
L’auto-évaluation favorise les échanges sur les points
forts de chaque établissement et permet de les adapter à
son établissement.
Il est vrai que la mise en place des différents types
d’améliorations nécessaires dépend, des
orientations stratégiques du centre hospitalier et des
possibilités d’action de chacun.
Mais la validation du plan d’action
du
Groupement Hospitalier de l’Est Francilien, prendra toute sa
dimension lors de la création d’un groupe sur le pilotage de la
démarche dans les établissements respectifs.
Tout cela m’a donné la possibilité de voir
différents établissements avec un enjeu
politique-économique en commun, mais des fonctionnements
d’exploitations des services biomédicaux différents, du
fait de leurs histoires respectives.
Il reste indéniable que le rapprochement des services
biomédicaux avec l’exploitation
de
l’outil
d’autodiagnostic
et
de
ses
évolutions,
est
la
solution
pour
garantir
la
qualité
et
la
sécurité
des
soins délivrés aux patients et
également si
l’on aspire à la recherche d’efficience au sein d’un groupement
Hospitalier.
A.Définitions
[G1] Certification :
C'est une procédure
destinée à faire valider, par un organisme
agréé indépendant, la conformité du
système qualité d'une organisation aux normes ISO 9000 ou
à un référentiel de qualité officiellement
reconnu.
[G2] Qualité :
Aptitude d’un ensemble de
caractéristiques intrinsèques à satisfaire des
exigences (source ISO 9000).
[G3] Critère :
Les critères permettent
d’identifier les tâches en détaillant les activités
à remplir ou les résultats majeurs à obtenir pour
considérer qu’une bonne pratique soit réalisée
avec succès. Les critères de réalisation peuvent
donc servir d'items à évaluer dans le cadre d'audits
internes ou d'autoévaluations des pratiques.
[G4] Management :
Activités coordonnées
pour orienter et contrôler une organisation
[G5] Tableau :
E1
Prévoir
- L’établissement a défini un système de
gestion des équipements biomédicaux, comprenant un plan
pluriannuel de remplacement et d’investissement.
- Une procédure (équipement de secours, solution
dégradée ou dépannage d’urgence) permettant de
répondre à une panne d’un équipement
biomédical critique est formalisée et est
opérationnelle.
E2 Mettre en œuvre
- Le système de gestion des équipements
biomédicaux est mis en œuvre sous la responsabilité d’un
professionnel identifié.
- La maintenance des équipements biomédicaux
critiques est assurée et les actions sont tracées.
- Les professionnels disposent des documents nécessaires
à l’exploitation des équipements biomédicaux.
- Les patients et leurs familles sont informés de la
conduite à tenir en cas de dysfonctionnement (alarme…) des
équipements biomédicaux installés au domicile. HAD
E3 Évaluer et améliorer
- La gestion des équipements biomédicaux est
évaluée et donne lieu à des actions
d’amélioration.
[G6] Définition d'un
dispositif médical
On entend par dispositif
médical, tout instrument, appareil, équipement,
matière, produit, à l'exception des produits d'origine
humaine, ou autre article utilisé seul ou en association , y
compris les accessoires et logiciels intervenant dans son
fonctionnement, destiné par le fabricants à être
utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont
l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens
pharmacologiques ou immunologiques, ni par métabolisme, mais
dont la fonction peut être assistées par de tels moyens.
[
N1]
Niveau de réalisation des
activités planifiées et d’obtention des résultats
escomptés. Les indicateurs d’efficacité permettent de
savoir si la bonne pratique donne les "résultats attendus" et
atteint les objectifs définis. Ils sont donc en
général directement associables aux processus
eux-mêmes déclinés en critères de
réalisation à mettre en œuvre.
[G8] Efficience :
Rapport entre le résultat obtenu
et les ressources utilisées. Etre efficace à moindre
coût. Les indicateurs d’efficience permettent d'évaluer
"le rendement interne" du service biomédical en identifiant
généralement le temps passé par les acteurs et les
ressources consommées pour obtenir les résultats
d'efficacité de la bonne pratique.
[G9] Processus :
Ensemble d’activités
corrélées ou interactives qui transforme des
éléments d’entrées en éléments de
sortie. Définir les processus consiste à expliciter
l'enchaînement des actions afin de produire le résultat
attendu d’une bonne pratique.
[G10] Définition et
analyse de la criticité d'un
dispositif médical :
Le décret 2001 – 1154 du 05
décembre 2001[
N2] et
l’arrêté du 03 mars 2003 [
N3]
fixent
l’obligation
de
maintenance
et
de
contrôle
qualité
et
la
liste
des
dispositifs
médicaux
soumis
à
cette
obligation.
Outre les équipements de
radiodiagnostic, radiothérapie, médecine
nucléaire, les dispositifs médicaux de classe II b et III
sont concernés par ces obligations.
Les services biomédicaux en
collaboration avec les parties prenantes (les services de soins, les
services médicaux, les services médico-techniques)
listent les dispositifs médicaux jugés critiques et
analysent leur criticité afin de prévoir et d’organiser
des solutions de secours en cas de panne.
Tout cela dans le souci de garantir la continuité d'utilisation
pour maintenir la qualité et la sécurité des soins.
Chaque établissement de santé peut définir sa
propre liste de dispositifs médicaux critiques en fonction de
ses activités médicales, de son mode de fonctionnement et
du nombre de ses équipements biomédicaux.
L'analyse des risques et les différents niveaux de
criticité peuvent donc être spécifiques à
chaque établissement.
Plusieurs méthodes existent pour analyser et évaluer
cette criticité en particulier la méthode PIEU ou la
méthode AMDEC.
[G11] Diagnostic :
"Description et analyse de
l´état d´un organisme, d´un de ses secteurs ou
d´une de ses activités, en matière de
qualité, réalisé à sa demande et à
son bénéfice, en vue d´identifier ses points forts
et ses insuffisances, et de proposer des actions
d´amélioration en tenant compte de son contexte technique,
économique et humain."
[G12] Benchmarking :
Terme anglophone très
usité. En français référenciassions ou
étalonnage est une technique de marketing ou de gestion de la
qualité qui consiste à étudier et analyser les
techniques de gestion, les modes d’organisation des autres entreprises
ou entité afin de s’en inspirer et de retirer le meilleur. C’est
un processus continu de recherche, d’analyse comparative, d’adaptation
et d’implantation des meilleures pratiques pour améliorer la
performance des processus dans une organisation (source Guide v2011).
B.Règlementations et
Normes
[N1]Décret 2001-1154 du 5
décembre 2001
Relatif à l'obligation de
maintenance et au contrôle qualité des dispositifs
médicaux prévus à l'article L.5212-1 du code de la
santé publique, Troisième partie : Décret JORF
n°284 du 7 décembre 2001 page 19481, NOR : MESP0123968
[N2] Arrêté du 3 mars
2003
Fixant les listes des dispositifs
médicaux soumis à l'obligation de maintenance et au
contrôle qualité mentionnée aux articles L.5212-1
et D.665-5-3 du code de la santé publique (texte n°26), JORF
n°66 du 19 mars 2003 page 4848, NOR : SANP0320928A
[N3] Arrêté du 03
mars 2003
[N4] NF EN 17050
Evaluation de la conformité –
Déclaration de conformité du fournisseur
Cette norme européenne NF EN ISO/CEI 17050 : 2004
homologuée par l’AFNOR en 2005 a le statut d’une norme
française, elle reproduit intégralement la norme
internationale ISO/CEI 17050 : 2004 et remplace l’EN 45014 : 1998
La norme NF EN ISO/CEI 17050 : 2005 présentée sous
le titre général « Evaluation de la
conformité – Déclaration de conformité du
fournisseur », permet l’évaluation de la conformité
et permet également au fournisseur de s’auto déclarer
conforme aux exigences de documents normatifs. Cette norme comprend 2
parties :
- ISO/CEI 17050-1 : Exigences générales
Cette première partie spécifie les exigences
générales applicables à la déclaration de
conformité du fournisseur dans les cas où il est
souhaitable, ou nécessaire, d’attester la conformité d’un
objet à des exigences spécifiées, quel que soit le
secteur concerné. Pour les besoins de cette partie de l’ISO/CEI
17050, l’objet d’une déclaration de conformité peut
être un produit, un processus, un système de
management, une personne ou un organisme.
- ISO/CEI 17050-2 : Documentation d’appui
Cette deuxième partie spécifie les exigences
générales relatives à la documentation d’appui
permettant de justifier la déclaration de conformité du
fournisseur décrite dans la première partie.
Ce terme de fournisseur est un terme générique qui
intègre toute entité qui souhaite se conformer à
un référentiel.
Le document d’appui contenant les preuves sur lesquelles le service
biomédical peut se baser pour émettre son
auto-déclaration peut être la grille d’autodiagnostic.
Champ d’amélioration et évolution de la norme :
Par rapport au document remplacé (EN 45014 : 1998), le champ de
la déclaration de conformité du fournisseur est
étendu puisque, outre les produits, processus et services, la
déclaration de conformité peut aussi porter sur les
systèmes de management, les personnes et les organismes. De
plus, le contenu de la documentation d’appui est précisé
ainsi que les exigences s’y rapportant (disponibilité,
durée de conservation, etc.).
Systèmes de management de la
qualité - Principes essentiels et vocabulaire
L'ISO 9000:2005 décrit les
principes essentiels des systèmes de management de la
qualité, objet de la famille des normes ISO 9000, et en
définit les termes associés.
Elle est applicable :
a.aux organismes cherchant à progresser par la mise en œuvre
d'un système de management de la qualité;
b.aux organismes qui cherchent à s'assurer que leurs
fournisseurs satisferont leurs exigences relatives aux produits;
c.aux utilisateurs des produits;
d.aux personnes concernées par une compréhension mutuelle
de la terminologie utilisée dans le domaine du management de la
qualité (par exemple fournisseurs, clients, autorités
réglementaires);
e.aux personnes internes ou externes à l'organisme, qui
évaluent ou auditent le système de management de la
qualité en termes de conformité aux exigences de l'ISO
9001 (par exemple auditeurs, autorités réglementaires,
organismes de certification/enregistrement);
f.aux personnes internes ou externes à l'organisme qui donnent
des conseils ou fournissent une formation sur le système de
management de la qualité qui lui convient;
g.aux personnes qui élaborent
des normes apparentées.
[N6] ISO 9001 :
Systèmes de
management de la qualité -
Exigences
C’est le référentiel qualité international
le plus connu et le plus exploité par les entreprises du secteur
marchand et de plus en plus
par les organisations du secteur
non-marchand. Il vise à démontrer
le respect des exigences de
management qualité pour garantir
la meilleure satisfaction des clients,
publics ou bénéficiaires
vis-à-vis d’activités ou d’engagements
spécifiés.
Gestion des performances durables d'un
organisme - Approche de management par la qualité
L'ISO 9004:2009 fournit des lignes
directrices permettant aux organismes de réaliser des
performances durables par une approche de management par la
qualité. Elle s'applique à tout organisme, quels que
soient sa taille, son type et son activité.
L'ISO 9004:2009 n'est pas destinée à être
utilisée dans un cadre réglementaire, contractuel ou de
certification.
Tous les liens ci-dessous ont
été consultés de 7 juin 2011
[R1] : Site internet de la Haute
Autorité de Santé,
présentation de la HAS :
[R2] : Site internet de la Haute
Autorité de Santé :
[R3] : Site internet du centre
hospitalier de Meaux
[R5] : Site internet du centre
hospitalier de Coulommiers
[R7] : Site internet du centre
hospitalier de Lagny marne la
Vallée
[R8] Organigramme fonctionnel
complet du service biomédical,
source Service Biomédical du CH Lagny marne la
Vallée.
[R9a] : Manuel v2010 de
certification des établissements de
santé - version Avril 2011, Haute Autorité en
Santé
Version complète :
[R9b]Manuel v2010 de
certification des établissements de
santé - version Avril 2011, Haute Autorité en
Santé critére 8K
[R10] Elaboration d’une Grille
d'autodiagnostic sur le Critère
8k v2010 de l'HAS, E. Lemarchand, A.
Kwizera, E. Germanicus, T. Roblès, Projet d'intégration,
Certification Professionnelle TSIBH, UTC, 2008-2009 Site internet:
[R11] : Site internet officiel
de l’Organisation Internationale de
Normalisation, ISO 9000:2005 :
[R12] : Site internet officiel
de l’Organisation Internationale de
Normalisation, ISO 9004:2009 :
[R13] :
Auto-évaluation sur le
critère 8K des services biomédicaux du Groupement Hospitalier de l'Est Francilien,
David DA
COSTA, Projet de stage, Certification Professionnelle
ABIH,
UTC, 2011,
Résultats du benchmarking entre différents Services
Biomédicaux
Tous les liens de cette section se trouvent dans la page de Gilbert
Farges du site internet de l’UTC :
Table des
figures :
Figure
1
: Organigramme fonctionnel complet du service
biomédical, Source [R13]
Figure
2
: Organigramme fonctionnel complet du service
biomédical, Source [R13]
Figure
3
: Organigramme fonctionnel complet du service
électricité-biomédical, Source [R8]
Figure
4
: Tableau du critère 8k de l’HAS, Source [G5]
Figure
5
: Diagramme audit, Source [R13]
Figure
6
: Cartographie du processus "Utilisation de
la grille autodiagnostic", Source [R13]
Figure
7
: Déroulement de l’auto-évaluation, Source [R13]
Figure
8
: Criticité CR= P× I ×E ×U, Source [A3]
Figure
9
: Criticité CR= F× G × D, Source [A3]
Figure
10
: Cartographie
niveaux HAS de Meaux, Source [R13]
Figure
11
: Cartographie processus métier de Meaux, Source [R13]
Figure
12
: Cartographie
niveaux HAS de Coulommiers, Source [R13]
Figure
13
: Cartographie processus métier de Coulommiers, Source [R13]
Figure
14
: Cartographie
niveaux HAS de Lagny Marne la Vallée, Source [R13]
Figure
15
: Cartographie processus métier de Lagny Marne
la Vallée, Source [R13]
Figure
16
: Cartographie
niveaux HAS du GHEF, Source [R13]
Figure
17
: Cartographie processus métier du GHEF, Source [R13]
Figure
18 : Paysage Lagny Marne la Vallée, source [R7]
Figure 19 : Logo
Centre Hospitalier de Meaux, source [R3]
Figure 20 : Logo
Centre Hospitalier de Coulommiers, source [R5]
Figure 21 : Logo
Centre Hospitalier de Lagny Marne la Vallée, source [R7]
[A1]Planning
sur
les
axes
d’améliorations
à
mettre
en
place.
[A2] Exemple
de
«
fiche
de
suivi
matériovigilance
»
[A3] Méthodes
pour
le
recensement
des
DM
critiques
:
Méthode
PIEU
:
La méthode PIEU permet de calculer la criticité d'un
dispositif médical en tenant compte des incidences des pannes
sur la santé du malade, de son importance stratégique, de
son état et de son taux d'utilisation.
Cette criticité PIEU (exprimée sous forme d'indice)
permet de mettre en évidence et de hiérarchiser les
équipements sensibles sur lesquels doit être axée
en priorité la politique de maintenance.
Plus l'indice est petit, plus le dispositif médical est critique.
Aucune des pondérations n'est égale à 0 afin de
mieux hiérarchiser les différents dispositifs
médicaux critiques.
Grille d'évaluation de la criticité appliquée
à un dispositif médical
Méthode
d’AMDEC
Analyse des Méthodes de Défaillance, de leurs Effets et
de leur Criticité (résultats exprimés en
pourcentage).
Plus CR est grand, plus le dispositif médical est critique.
L’AMDEC est une méthode d’analyse prévisionnelle de la
faisabilité permettant de recenser systématiquement les
défaillances potentielles d’un dispositif médical puis
d’estimer les risques liés à l’apparition de ces
défaillances, afin d’engager les actions correctives à
apporter au dispositif.
Elle a pour objectif de minimiser les risques, le coût de non
qualité et les pertes d’exploitation.
[A4]Exemple
de
procédure
sur
la
«
conduite
à
tenir
en
cas
de
panne
d’un
DM
critique
»
[A5] résultat
HAS
Meaux
[A6] résultat
des
processus
Meaux
[A7] Résultat
HAS
Coulommiers
Figure 12:
Cartographie
niveaux
HAS
de
coulommiers
[A8] résultat
des
processus
Coulommiers
Figure
13:
Cartographie
processus
métier
de
Coulommiers
[A9] Résultat
HAS
Lagny
Marne
la
Vallée
Figure
14:
Cartographie
niveaux
HAS
de
Lagny
Marne
la
Vallée
[A10] résultat
des
processus
Lagny
Marne
la
Vallée
Figure
15:
Cartographie
processus
métier
de
Lagny
Marne
la Vallée